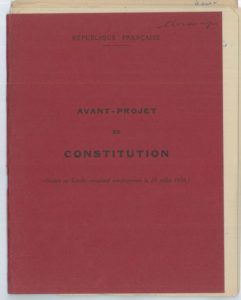 En septembre 2008, L’OURS hors série Recherche socialiste n°43-44 a publié un dossier consacré au 50e anniversaire de la constitution de 1958, vu du côté des socialistes. On peut y lire des articles de Gérard Grunberg (Le Parti socialiste et les institutions), Bernard Rullier (Les débats constitutionnels du Parti socialiste) et Denis Lefebvre (Guy Mollet et les socialistes en 1958). Parmi les documents proposés, un long entretien accordé par André Chandernagor à Denis Lefebvre à (re)découvrir ici.
En septembre 2008, L’OURS hors série Recherche socialiste n°43-44 a publié un dossier consacré au 50e anniversaire de la constitution de 1958, vu du côté des socialistes. On peut y lire des articles de Gérard Grunberg (Le Parti socialiste et les institutions), Bernard Rullier (Les débats constitutionnels du Parti socialiste) et Denis Lefebvre (Guy Mollet et les socialistes en 1958). Parmi les documents proposés, un long entretien accordé par André Chandernagor à Denis Lefebvre à (re)découvrir ici.
« Nous publions la retransciption de l’entretien que nous a accordé cet été, en toute liberté, André Chandernagor : retour sur l’élaboration de la Constitution de 1958 telle qu’il l’a vécue dans l’entourage de Guy Mollet, après avoir, dès le gouvernement de Front républicain en 1956-1957, été l’un de ses interlocuteurs privilégiés sur les questions constitutionnelles.
Il avait été chargé par le président du Conseil (convaincu qu’il fallait sortir de ce système de la IVe République, avec ses dévoiements) de réfléchir aux questions constitutionnelles, et d’avancer certaines propositions.
Sans fard, pendant trois heures, André Chandernagor nous a livré ses réflexions d’homme engagé, de socialiste. Nous avons conscience qu’il nous offre ce témoignage pour notre revue parce qu’il va être publié comme une contribution à notre histoire contemporaine. Dans une autre publication, le conseiller d’État, l’ancien ministre aurait peut-être été enclin à policer ses propos. Nous le remercions de sa confiance et de l’intérêt qu’il manifeste à nos travaux. »
Denis Lefebvre
Dès 1956-1957, dans les archives de Guy Mollet, on trouve l’amorce de réflexions sur les questions constitutionnelles : correspondances, notes diverses. Comment l’expliques-tu?
André Chandernagor : Quand il devient début 1956 président du Conseil, dans des conditions très difficiles, avec l’affaire d’Algérie devant nous, Guy Mollet est sans illusion sur deux choses.
D’abord, sur la faiblesse de l’exécutif par rapport au Parlement. Lui-même bénéficie d’une majorité très composite, puisque les communistes le tolèrent, le soutiennent même parfois, tandis que la majorité comprend des anciens gaullistes des radicaux, des démocrates-chrétiens. Il sait très bien qu’avec une majorité comme celle-là, il peut être lâché à tout moment.
Ensuite, il sait aussi, parce que c’est la procédure que, pour obtenir le vote d’une loi, il faut poser la question de confiance un nombre incalculable de fois. Il devra d’ailleurs le faire tout au long de son gouvernement.
Il mesure donc les limites du système, et tu les vis à ses côtés…
Quand j’arrive à Matignon, je suis frappé par deux impressions contradictoires. Tout d’abord, le président du Conseil peut travailler. Et Guy Mollet est un travailleur, souvent solitaire, il aime travailler dans son bureau sans être dérangé. Au bout d’un certain temps, j’aurai le privilège de pouvoir frapper à sa porte et entrer directement dans son bureau… il s’est rendu compte que je ne le dérangeais pas pour rien.
Mais, d’autre part, ce président est obligé d’aller à tel et tel moment à l’Assemblée, en vitesse, parce qu’il s’y passe quelque chose, en fonction des humeurs des parlementaires.
La vérité, c’est que nous sommes dans un régime d’assemblée, et que l’Assemblé gouverne.
Ce n’est pas un régime parlementaire au sens anglais du terme.
Cela, Guy Mollet le sait, et il est convaincu que l’exécutif n’est pas suffisamment armé. Au fond, il fait à presque 15 ans de distance le même cheminement que Léon Blum. Dans À l’échelle humaine, on trouve un passage où Blum écrit qu’il faut renforcer l’exécutif. Mais ces développements n’avaient pas été bien reçus par le Parti socialiste, qui restait attaché au régime d’assemblée, parce qu’il vivait encore avec les souvenirs de la Révolution française, de la Convention. On oubliait simplement que la Convention était un régime d’assemblée tempéré, si j’ose dire, par la dictature de la Terreur. Guy Mollet avait déjà mené cette réflexion.
Ensuite, il est absolument convaincu qu’avec le système de révision constitutionnelle tel qu’il est écrit dans la Constitution de 1946… toute révision était impossible. C’était totalement impraticable.
Il va me charger d’une réflexion sur la révision de la Constitution, en sachant bien qu’un tel projet ne pourrait pas être présenté vite devant le Parlement. Ce qui explique qu’il résistera à toutes les pressions qui s’exerceront sur lui, et il y en aura, notamment de la part du MRP, par la voix de Pflimlin, pour mettre en place une commission parlementaire de réflexion ad hoc : il donnera à chaque fois des réponses dilatoires, car il sait très bien que cela ne pourrait déboucher sur rien. Cela n’empêchera pas la réflexion, de nous et des autres. L’article 49-3 sortira à la fois de mes propres réflexions, conjuguées à celles de Guy Mollet, et de celles du MRP.
Donc, Guy Mollet me donne mission de réfléchir à la Constitution.
C’est ta tâche principale au cabinet de Guy Mollet ?
J’avais plusieurs missions à Matignon.
D’abord, les questions juridiques. On me fait passer un certain nombre de textes, sur lesquels je donne mon point de vue, et je travaille directement avec le secrétariat général du gouvernement, et le secrétaire général, un membre du Conseil d’État, et avec le directeur des affaires juridiques, Jérôme Solal-Céligny.
Par ailleurs, comme j’avais été auparavant au cabinet de Marius Moutet, que j’avais fait l’École coloniale avant de faire l’ENA, que j’avais été un temps administrateur adjoint du service civil de l’Indochine, on me charge de veiller sur tous les textes concernant la loi-cadre de l’outremer. Ce qui me vaudra, ceci dit en passant, mes premières « engueulades » homériques avec Gaston Defferre : les premiers textes qu’il a présentés sur cette affaire n’auraient jamais pu passer devant le Conseil d’État, car ils n’avaient aucune forme juridique ! Je me souviens des colères de Gaston Defferre qui voulait aller très vite. On a fini par régler le problème avec Pierre Messmer, son directeur de cabinet. C’est un conseiller d’État, Mégret (le père de l’autre) qui a réécrit tous les textes.
Enfin, comme j’étais en même temps rapporteur au titre du Conseil d’État devant le conseil supérieur de la Sécurité sociale, je suivais aussi les questions sociales.
Guy Mollet me charge donc des questions constitutionnelles. Là, j’ai beaucoup travaillé avec Jérôme Solal-Céligny. Je ne savais pas du tout, à l’époque, qu’il était apparenté aux Debré.
J’étais convaincu dès le début que, pour pouvoir gouverner, un gouvernement devait pouvoir compter sur la durée. La durée, il ne pouvait l’avoir qu’en fidélisant une majorité. Cela regardait le mode de scrutin, bien sûr, mais aussi la manière dont s’engageait la responsabilité du gouvernement. Il fallait donc corriger la procédure de cette question de confiance posée à répétition, et demander à l’Assemblée de faire la preuve contraire… cela, c’était une grande idée de Guy Mollet, qui disait en substance… c’est bien beau de renverser un gouvernement, mais ensuite ? Donc, démontrer qu’il y a une majorité politique pour autre chose. C’est en définitive le système qu’on a utilisé par la suite.
Point de départ de la réflexion, donc : assurer la durée. Mais aussi donner les moyens au gouvernement de faire prévaloir sa politique, tant qu’il n’est pas renversé. C’est là qu’est arrivée l’idée des lois-cadre.
L’idée essentielle de Guy Mollet était la suivante : faire une loi-cadre, et renvoyer au décret ensuite la possibilité de la mettre « en musique ». Mais encore fallait-il qu’elle soit votée, et qu’elle soit suffisamment explicite, car c’est la loi. Nous n’en étions pas encore à différencier le régime de la loi de celui du décret, qui est apparu en 1958. Mais il y avait cette idée. Alors, le vote de la loi-cadre ? Là est née l’idée du 49-3, pour engager la confiance sur un texte auquel le gouvernement tient. Sinon, disait Guy Mollet, ce texte serait détricoté par petits morceaux par l’Assemblée. Ce qui est vrai !
Guy Mollet avait aussi noté que beaucoup des gouvernements de la IVe République n’avaient pas été renversés selon la procédure constitutionnelle : ils sont partis parce qu’on leur refusait des textes essentiels pour gouverner.
L’article 49-3 occupe aujourd’hui encore les esprits…
Actuellement, je constate qu’on veut réviser le 49-3. Je veux bien… On dit qu’on ne pourrait l’utiliser que sur tel ou tel texte… mais est-on capable de déterminer quels sont les textes importants à un moment donné ? Ce qui fait l’importance d’un texte, c’est la conjoncture. Personne ne peut savoir ce qu’elle sera. Donc, si un texte important ne figure pas dans la liste exhaustive qu’on va établir à un moment donné, le gouvernement se trouvera désarmé. C’est pour cela que je suis très réservé sur la modification du 49-3, mais peu importe ici.
Là-dessus, Guy Mollet et moi avions la même analyse.
Qui s’intéresse aux questions constitutionnelles à l’intérieur de la SFIO ?
Étienne Weill-Raynal, bien sûr. Mais il était plus un rédacteur de notes selon le moment, son inspiration, un éveilleur d’idées plus qu’un homme aux convictions bien arrêtées. Finalement, il pose des questions.
Mais, dans le Parti, il n’y a pas de groupe de réflexion constitué sur les questions constitutionnelles. Il n’y a jamais de débat. Finalement, les socialistes se satisfont de ce régime d’assemblée.
On pourrait bien sûr citer Albert Gazier, ou Jean Minjoz, qui aimait les études juridiques. Mais à part ceux-là, jusqu’en 1958… pas grand monde. Pas davantage ensuite, d’ailleurs.
Donc, moi, je suis chargé de réfléchir, et aussi d’aider Guy Mollet à réfléchir. Guy Mollet aimait débattre de ces questions. J’ai gardé un souvenir merveilleux de nos conversations de cette époque. De longues conversations.
Guy Mollet est aussi en relation à ce propos avec quelques chefs de partis politiques. Pierre Pflimlin, par exemple, qui le rencontre assez souvent à ce propos. Mais les idées de Guy Mollet sont déjà bien arrêtées, très tôt. On est là face à quelque chose, qui tend probablement à expliquer (ce n’est certes pas l’argument essentiel) pourquoi en définitive il se rallie à de Gaulle en 1958. C’est une des raisons.
Donc, la question institutionnelle joue un rôle en 1958 ?
Absolument. Au risque de me répéter, Guy Mollet était convaincu qu’il fallait réformer la Constitution, mais que cela ne pourrait pas se faire dans le système de l’époque. Mais il n’aurait jamais pu aller contre la République.
Mes réflexions de l’époque avaient abouti à une note que je lui avais envoyée, rédigée avec Solal, dans laquelle tout était développé. Je me souviens que quand j’ai finalisé cette note, Solal m’a dit : « Ah, c’est bigrement bien, mais c’est trop tôt ». À l’époque, je n’ai pas prêté attention à ces quelques mots… Solal, lui, savait ce qui était en train de se préparer.
Bien sûr, arrive ensuite mai 1958…
Mai 1958 n’était sans doute pas un coup d’État, mais cela y ressemblait quand même ! Guy Mollet a contribué largement à assurer un habillage légal à une opération qui ne l’était pas.
Qu’y avait-il d’autre à faire ?
Rien. Rien. Il aurait fallu avoir le soutien de la population… mais elle ne soutenait plus la IVe République. Pour des tas de raisons, dont cette instabilité ministérielle qui n’était plus admise. Mais il faut aussi mettre en avant l’affaire d’Algérie.
Le nouveau gouvernement s’attelle donc à la rédaction d’une nouvelle Constitution. Quel est ton rôle ?
J’ai eu une parenthèse de quelques mois. À la chute de Guy Mollet, je me suis retrouvé au cabinet de Gérard Jaquet, alors chargé de l’Outre-mer. Je suis chargé des affaires politiques. Ce dernier me propose de partir comme commissaire de la République dans un de nos territoires. C’était une proposition tout à fait intéressante, dont j’aurais rêvé autrefois. Mais, là, je sens bien que l’outre-mer ne va pas durer, ce n’est pas le moment de partir. Qui plus est, je suis déjà maire dans la Creuse, je suis fédéral adjoint et, en réalité, j’assure la direction de la fédération. Je refuse donc cette proposition. Arrivent les événements de mai 1958, Guy Mollet devient ministre d’État, je le rejoins immédiatement dans le petit hôtel particulier en face de Matignon.
Je m’occupe en grande partie des questions constitutionnelles.
Le système fonctionne de la façon suivante : on confie à Michel Debré, le garde des Sceaux, l’animation d’un groupe de travail qui prépare les textes ; l’échelon suivant (de Gaulle et les ministres d’État) revoit les textes, et propose des solutions, si le besoin s’en fait sentir, dans une structure assez souple ; enfin, le conseil des ministres, qui est là pour bénir le tout. Donc, l’échange est complet, sur tout. Je suis le porte-parole de Guy Mollet au groupe de travail de Debré. De même que les autres politiques ont leurs porte-parole : Pflimlin, Houphouët-Boigny, Jacquinot. Les autres membres de ce groupe sont des collaborateurs directs de Michel Debré. La majeure partie d’entre eux sont des membres du Conseil d’État. Debré s’appuie beaucoup sur Pierre Racine. J’y retrouve donc des personnes que je connais de longue date. Si bien que l’atmosphère de travail est très libre. Debré a des aspects extérieurs souvent détestables, un peu colérique, mais en animateur d’un groupe de travail, il encourage les débats, la discussion. C’était très intéressant. On peut tout dire, il admet tout.
Comment fonctionnes-tu alors avec Guy Mollet ?
Il me tient informé de tout ce qui se raconte à son niveau, et moi de même. Il me demande, sur des points particuliers, de rédiger certaines notes.
Nous nous voyons quasi quotidiennement, même quand il déjeunait dans les sous-sols de l’hôtel particulier qui hébergeait son ministère d’État.
As-tu une « équipe » même modeste, avec toi ?
Je suis seul. De temps en temps, je parle avec Étienne Manac’h, le directeur de cabinet de Guy Mollet, mais il n’interfère pas beaucoup dans ces affaires. Étienne Weill-Raynal m’envoie ici ou là quelques notes. Je n’ai aucun contact avec les parlementaires socialistes.
Qui plus est, tout cela s’est passé très vite : l’affaire a été bouclée en deux mois.
Que tentez-vous de faire passer dans ces courtes semaines ?
Le problème devant lequel on est, je le mesure tout de suite, c’est de garder un caractère parlementaire au nouveau régime. Ce n’était pas évident au départ, au vu de la personnalité de De Gaulle, quand même. On l’a connu en 1946, on imagine qu’il n’a pas beaucoup changé. Il a cependant évolué sur sa façon de présenter les choses : il a fait des progrès considérables. Mais on comprendra très vite qu’il n’a en rien changé dans ses idées et qu’au fond, pour lui, le régime parlementaire serait plus proche de la Monarchie de Juillet… lui en Louis-Philippe, quoi.
Alors, comment faire que le régime reste parlementaire ? C’est-à-dire avec un gouvernement responsable devant le Parlement. Et comment faire dans ce système une place renforcée au gouvernement (cela, nous y sommes près et nous savons à peu près comment faire, on l’a étudié avant) avec une nouvelle dimension : il va y avoir un président de la République, qui évidemment sera de Gaulle. Et comment arriver à faire sa place à ce président d’un type un peu inhabituel dans nos institutions, au moins depuis la IIIe République, et comment articuler tout cela ?
Alors, pour ce qui est du régime parlementaire, nous avons une chance : c’est que Debré est parlementaire, et parlementariste. Heureusement ! Cela facilite les choses. On arrivera en effet à inscrire dans la Constitution un système qui est parlementaire, avec ce qu’on va dénommer (Debré aussi) un système parlementaire rationalisé. On dira d’abord « assaini », puis « rationalisé », car assaini cela ne faisait pas bien, notamment pour les prédécesseurs. « Rationalisé », cela veut dire qu’on va introduire un certain nombre de dispositions, le 49-3, et d’autres auxquelles nous n’avions pas songé : la discussion sur le projet du gouvernement et pas sur la proposition de la commission ; le problème de la motion de censure, il faut voter pour renverser le gouvernement. Tout cela ne fera pas de difficultés majeures. Là où il y aura problème, c’est pour introduire ce président nouvelle manière !
Donc, si je comprends bien, il y a accord sur la quasi-totalité ?
Certes. Il y a des discussions sur des questions de détail.
Mais il y a cependant deux choses qui sont difficiles à avaler. Le Sénat tout d’abord. J’entends encore Debré dire qu’il y aura une assemblée divisée (on le croyait à l’époque… on part toujours de l’expérience précédente) et donc il faut un contrepoids en face qui ait la durée, le Sénat. Lui-même était sénateur. Il évoquait un mandat de 9 ans. Je me souviens avoir ironisé… pourquoi pas des pairs à vie ! Je trépignais pendant ces discussions, car je me battais pour réduire la durée du mandat des sénateurs. D’autant qu’en même temps, quand on envisageait l’élection du président de la République, on faisait appel à un corps électoral large, mais sans suffrage universel. Bien sûr, le maintien du Sénat pouvait se justifier. Ce n’était pas le moment de se mettre à dos les sénateurs, ni les maires, etc. Donc, il a fallu avaler le Sénat, et la seule discussion portait sur la durée du mandat, que j’aurais voulu réduire, Guy Mollet aussi, mais bon…
Bien sûr, la grande difficulté tenait à la question du président de la République. La discussion va se trouver biaisée, faussée, par la façon dont de Gaulle présente la chose, en faisant à chaque fois référence à 1940, en disant… mais, votre président, s’il n’a pas la possibilité d’incarner lui-même à un certain moment la République pour la sauver, que faisons-nous ?
D’où l’article 16, objet de grandes discussions. Il y a les questions politiques, mais aussi le droit commun, c’est-à-dire : quelle est la position normale, la place, du président par rapport au Premier ministre, par rapport au Parlement ? D’un autre côté, il n’y a pas eu de problèmes majeurs sur la question de la dissolution.
Mais les difficultés sont venues quand de Gaulle a avancé la notion d’arbitre… Il demande que le président de la République ait un pouvoir d’arbitrage. Nous voilà partis dans le vocabulaire. Qu’est-ce cela veut dire, « arbitre » ? Cette notion, je ne l’avais jamais rencontrée jusque-là dans mes études constitutionnelles !
Qu’est-ce qu’un président arbitre ? Il veille à la bonne marche des pouvoirs publics… ah bon !
Mais la politique étrangère ? Certes, il a été de tradition que, dans la IIIe République (cela a été valable pratiquement jusqu’en 1914), la politique étrangère soit du ressort du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. C’est vrai.
Il y a quand même eu de nombreux présidents du Conseil qui ont aussi été ministres des Affaires étrangères…
Certes. Mais le statut du président du Conseil n’est écrit nulle part. Il va se dégager après Mac-Mahon. En réalité, celui qui gouverne sous la IIIe République est le président de la République. Il y a une sorte de Premier ministre, qui est le Premier ministre du Président.
Chaque fois qu’on invoque la IIIe, on est dans le doute… avant ou après 1914 ?
C’est ce que je dirai du reste un jour à Guy Mollet, après qu’il m’ait rapporté une rencontre avec de Gaulle, qui lui avait dit… la politique étrangère, c’est le président qui en est garant, c’est dans la tradition de la IIIe République.
Je ne sais pas si Guy Mollet avait bien mesuré… avant ou après ?
Dans notre conversation, Guy Mollet m’a demandé de préciser ma pensée. Je lui ai répondu : avant 1914, c’est le président qui impulsait. Après, c’est fini. Tout ressortissait du président du Conseil.
Que pensait finalement pouvoir faire Guy Mollet ?
En 1958, nous étions coincés par la conjoncture. Au fond, Guy Mollet se disait : on va essayer d’avoir un régime parlementaire, de Gaulle ne sera pas éternel, il commettra peut-être quelques erreurs… après, le Parlement finira par reconquérir une partie de ses pouvoirs. Et puis, il y a l’affaire d’Algérie qu’il faut régler, ce n’est pas facile. Enfin, les États-Unis dont déchaînés contre nous, comme l’ONU. Donc, la politique étrangère est un domaine difficile… dans la conjoncture du moment, laissons-là à de Gaulle, il est peut-être de taille de mener à bien ce dossier.
La conjoncture voulait qu’on lui laisse la politique étrangère, et l’avenir institutionnel (le régime parlementaire) aurait voulu qu’on ne la lui laisse pas. Là, ont commencé à naître les équivoques qu’on retrouve dans le texte : politique étrangère, défense nationale.
Les textes reflètent totalement cette ambiguïté ?
À tous les niveaux. Ainsi, quand on lit dans le texte que « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation », cela reflète tout à fait les idées de Michel Debré et de Guy Mollet, c’est très clair. Debré voudra s’appuyer là-dessus : cela se passera très mal avec le général à certains moments. Debré a dû en avaler, des couleuvres ! Sur les questions liées à la défense nationale, par exemple, alors que le gouvernement est censé être responsable de ces questions… Mais, en même temps, le président de la République est le chef des armées.
Le compromis ne va pas durer. Si je me souviens bien, la première entorse remonte à fin 1958, quand l’Assemblée nationale demande à la majorité la convocation du Parlement sur les problèmes agricoles. Cette demande est constitutionnelle. Quand il est écrit que « le Parlement est réuni, etc. », c’est évident qu’on doit le réunir. Mais le président n’a pas pris le décret, et le Parlement ne s’est pas réuni.
Dans ce cas précis, comme à chaque fois qu’il violera la Constitution, de Gaulle argumentera à plaisir, et il trouvera toujours quelques juristes complaisants pour justifier.
Michel Debré faisait de la figuration aussi intelligente que possible, car ce n’était pas un personnage négligeable. Mais il a avalé une tonne de sel tout au long de ces années, et quand de Gaulle s’est résolu à un certain moment à aller plus loin sur le plan institutionnel, il s’est séparé de lui.
Finalement, Debré était partisan d’un vrai régime parlementaire ?
Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu’il a été dans le passé au cabinet de Paul Reynaud, un grand parlementaire de droite. Ne pas oublier non plus qu’il s’est fait connaître quand il a été sénateur. Il accepte la discussion parlementaire, il l’aime même.
Je me souviens de débats très vifs à l’Assemblée avec lui quand il était Premier ministre. Un jour, je lui ai dit qu’il n’aspirait plus devant l’Histoire qu’à l’auréole du martyr de la fidélité. Nous nous retrouvons peu après en train de corriger chacun les épreuves de notre discours à la tribune. Il finit ses corrections avant moi, et vient me saluer : « Eh bien, Chandernagor, jusqu’à la prochaine fois ».
C’était un parlementariste.
Dans les débats de 1958, y a-t-il eu débat sur le mode de scrutin ?
Le mode de scrutin, c’est vraiment Guy Mollet qui l’a voulu, après consultation du Parti. De Gaulle s’en moquait.
C’est quand même extraordinaire…
C’est comme cela. En réalité, avec le système qu’on mettait en place, la proportionnelle aurait été meilleure, car l’Assemblée aurait été beaucoup plus diverse.
Nous n’étions pas dans le cas du système britannique, où le mode de scrutin est fondamental : à lui tout seul, il assure la solidité. Nous assurions, nous, la stabilité par quantité de combinaisons, et le mode de scrutin n’avait aucune importance. Toutes ces combinaisons, on les avait prises dans l’hypothèse d’une assemblée divisée, comme celle du régime précédent, à cause de la proportionnelle, et on ne supposait pas non plus que le scrutin majoritaire agirait comme dans le système britannique. Debré, lui, était partisan du système britannique à un tour : le scrutin d’arrondissement à un tour. Lui voulait par tous les moyens qu’il y ait une majorité qui se dégage. On lui propose un scrutin à deux tours : banco !
Et l’article 16 ?
Guy Mollet a été polarisé par l’article 16, comme les autres ministres politiques (Jacquinot, Pflimlin, je ne parle pas d’Houphouët-Boigny, ce n’était pas tellement son affaire), ils l’ont tous été… mettant en avant les dangers de l’article 16.
Ils n’ont pas mesuré suffisamment les dangers de l’équivoque des pouvoirs créée entre le Premier ministre et le président de la République. S’ils ont vu les ambiguïtés (sur la notion d’arbitrage) les circonstances faisaient qu’il fallait laisser à de Gaulle la responsabilité de régler l’affaire algérienne.
Cette notion d’arbitrage, tu la vois apparaître quand ? Dans les réunions à Matignon, ou dans ce que te raconte Guy Mollet des réunions entre « politiques » ?
Nous estimions que nous avions limité le problème par la notion d’arbitrage, assurant le fonctionnement des pouvoirs publics, avec dissolution quand le système ne marche pas. Mais pour Charles de Gaulle, arbitrer c’est décider à tout moment.
Et ça va très loin. La première entorse (c’est pour cela que je suis très vite révulsé) vient dès la fin décembre, je me répète, quand le Parlement demande à être réuni, et que de Gaulle répond que c’est à lui de décider, de convoquer. Or, c’est un droit inscrit dans la Constitution…
Quand les socialistes quittent le gouvernement fin 1958, est-ce lié à cette évolution prévisible de la Constitution ?
Non. La décision a été prise par Guy Mollet bien avant. Il faut bien voir que les élections nous ont étrillé, nous arrivons à 40 environ, dont beaucoup d’anciens… je suis le plus jeune avec Fernand Darchicourt et René Cassagne.
Donc, que pouvions-nous faire au gouvernement ? Nous ne pesions pas. Il était préférable d’être dans l’opposition. D’autre part, il ne fallait pas laisser le monopole de l’opposition au Parti communiste qui, certes, n’a que 10 députés, mais qui reste une force importante.
Mais l’équivoque, Guy Mollet va un certain moment l’entretenir. Je me souviens d’une discussion avec lui à propos des ordonnances. Quand Debré demande, cela doit être en janvier 1959, le pouvoir d’agir par ordonnances, ce qui est constitutionnel, Guy Mollet dans ses arguments de refus à la tribune de l’Assemblée dit en substance… « Si c’était le président de la République qui demandait les pleins pouvoirs pour une affaire comme l’Algérie, je les lui donnerais bien volontiers, mais vous…», etc.
Je ne comprends pas son argumentation, et je lui dis qu’il a ouvert une brèche.
Tu as suivi ces questions avec Guy Mollet jusqu’à la fin de 1958 ?
Pratiquement. Mais j’ai profondément regretté d’avoir été absent pendant la campagne du référendum et des législatives, car j’étais en campagne moi-même dans mon département. J’étais absent de la mi-septembre à la mi-novembre. C’est pendant ce temps-là que le groupe de travail Debré a « béni » les ordonnances d’application de la Constitution, et notamment celle sur la loi de finances, qui a donné tous les pouvoirs au ministère des Finances, tous. Je n’étais pas là, Guy Mollet non plus. Tout le monde était en campagne.
Vois-tu se lever dès l’été 1958 une opposition à la nouvelle Constitution ?
Certes, mais cela n’a pas pesé lourd, car les Français se moquent éperdument des questions constitutionnelles. On le voit pendant toute la campagne électorale, du référendum aux législatives.
Le seul argument qui comptait, que j’ai utilisé moi-même abondamment, a été celui-ci : « De Gaulle et Guy Mollet vous ont évité la guerre civile »… cela a marché à fond !
« La SFIO à l’avant-garde de la Ve République »… que pensais-tu de ce slogan ?
C’était une belle affiche. On n’en a jamais eu d’aussi belle !
Je crois que Guy Mollet y a cru.
Avant-garde sociale ? politique ?
Oh : avant-garde tout court. Il y a vraiment cru. Il a dû penser qu’il y aurait une majorité qui se dégagerait des élections de l’automne, et que la SFIO aurait pu être en tête, et qu’il redevienne Premier ministre.
Je me demande si de Gaulle n’a pas dû le « peloter » suffisamment pour cela. Car c’était un « peloteur », comme on l’a vu avec le comte de Paris un temps.
Mais on s’est ramassé une superbe veste…
Propos recueillis par Denis Lefebvre
POUR COMMANDER CE NUMÉRO : ENVOYER UN CHÈQUE DE 12 € POUR COMPRIS À L’OURS. ENVOI PAR RETOUR DU COURRIER.
Voir l’inventaire des archives d’André Chandernagor déposées à l’OURS.
