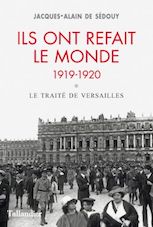 L’auteur est ancien ambassadeur et historien des relations internationales. Il a bénéficié d’archives inédites pour dresser un panorama d’ensemble, avec un siècle de recul, d’un traité aux conséquences énormes. À propos du livre de Jacques-Alain de Sédouy, Ils ont refait le monde, 1919-1920. Le traité de Versailles, Tallandier, 2018, 346p, 23,50€. Article paru dans L’OURS n°489, juin 2019.
L’auteur est ancien ambassadeur et historien des relations internationales. Il a bénéficié d’archives inédites pour dresser un panorama d’ensemble, avec un siècle de recul, d’un traité aux conséquences énormes. À propos du livre de Jacques-Alain de Sédouy, Ils ont refait le monde, 1919-1920. Le traité de Versailles, Tallandier, 2018, 346p, 23,50€. Article paru dans L’OURS n°489, juin 2019.
Le temps passé n’a fait qu’aiguiser la grande question : le traité de Versailles fut-il d’une dureté excessive, avec l’Allemagne en particulier, ou, au contraire, a-t-il couronné trop tôt la fin d’un conflit, pour que le perdant prenne pleinement conscience de sa défaite ?
Avant l’armistice
L’auteur remonte à juste titre aux derniers mois ayant précédé l’armistice, qui ont eu des incidences sur les négociations ultérieures. Ainsi, dès le 3 octobre 1918, Max de Bade, chef d’un nouveau gouvernement allemand tout récemment constitué, s’adresse aux États-Unis, sans en informer les autres belligérants, pour leur demander de prendre en main le rétablissement de la paix dans le cadre d’un arrêt des combats masquant la défaite allemande. Le dialogue entre eux va durer deux semaines sans que les alliés soient un seul moment consultés. Ils finiront par intervenir mais l’hypothèse d’une paix séparée entre Washington et Berlin aura plané pendant quelques jours, Paris et Londres se montrant prêts à poursuivre seuls les hostilités.
Cet épisode, suspendu par Wilson qui, de Washington, ne reprend pas les menaces de son envoyé House, pèsera sur l’armistice finalement conclu un mois plus tard. Le général Pershing, commandant en chef des troupes américaines, était, à titre personnel, favorable à la continuation de la guerre jusqu’à la capitulation sans condition d’une Allemagne dont le territoire aurait été envahi. Mais Clemenceau et Lloyd George, chef du gouvernement britannique, estimèrent tous deux que l’effusion de sang devait s’arrêter dès lors que les conditions imposées au vaincu lui rendaient impossible la reprise des hostilités. Elles prévoyaient la restitution de l’Alsace-Lorraine et l’évacuation de la rive gauche du Rhin, dans l’attente de la signature d’un traité de paix.
Le traité de paix
Celui-ci fut l’objet de longues négociations minutieusement décrites par l’auteur. 160 commissions furent réunies qui tinrent 1 500 séances. Les problèmes étaient multiples : les réparations exigées de l’Allemagne, la rive démilitarisée du Rhin, les revendications territoriales italiennes, la fin de l’empire austro-hongrois avec l’hypothèse d’un rattachement de l’Autriche à l’Allemagne, le couloir de Dantzig permettant un accès à la mer de la Pologne, l’incorporation dans le nouvel État tchécoslovaque d’une population allemande importante, etc.
Les deux derniers problèmes auront des conséquences décisives sur les conflits menant à la Seconde Guerre mondiale sans qu’on puisse affirmer, malgré le recul, que des solutions différentes les auraient évités.
Pour Wilson l’essentiel était la création d’une Société des nations (SDN) qui éviterait tous problèmes à l’avenir ou, en tous cas, fournirait un cadre pour les régler pacifiquement, en dépit de l’absence de moyens militaires, qu’il n’envisageait pas. On sait que le refus par le Sénat américain de ratifier le traité de Versailles fragilisa dès l’origine cette instance, désertée dès lors par les États-Unis.
La difficulté majeure consistait dans le maintien ou non de l’intégrité, à l’Ouest, du territoire allemand, avec l’exigence française, au minimum, de la démilitarisation de la rive occidentale du Rhin. Elle fut discutée par les quatre principales puissances : France, Grande-Bretagne, États-Unis et Italie, face auxquelles la délégation allemande renâcla avant de devoir s’incliner devant la fermeté de Clemenceau.
Mais le chef du gouvernement français l’emporta – partiellement – dans la douleur. La droite française et le maréchal Foch estimaient ses demandes insuffisantes alors que la gauche dénonçait un traité injuste car comportant des exigences excessives. Elle appuyait une vague de grèves à l’instigation de la CGT de Léon Jouhaux. Les États-Unis et la Grande-Bretagne freinaient vigoureusement de leur côté au point que le 20 juin 1919, huit jours avant la signature finalement réalisée, une crise entre les alliés fit planer la menace d’une reprise des hostilités. Finalement Wilson et Lloyd George firent pression dans le sens de Clemenceau et le gouvernement allemand céda.
Il n’en demeure pas moins que l’entente entre Paris et Londres n’a pas été excellente tout au long des négociations. Le climat qui avait régné durant la guerre s’est dégradé. La Grande-Bretagne a retrouvé sa crainte d’un impérialisme français sur le continent et a fait obstacle à ses prétentions vis-à-vis de l’Allemagne, dans la perspective d’une reprise économique des relations avec le vaincu. Au surplus, un traité de garantie entre les deux vainqueurs avait été signé ainsi qu’un autre englobant les États-Unis, les deux devant entrer en vigueur simultanément. Il tomba dès lors que Washington en refusa la ratification en même temps qu’il rejetait la SDN.
La signature en grande pompe à Versailles est bien décrite par Jacques-Alain de Sédouy. Mais, comme il le fait observer, d’importantes difficultés n’avaient pas été résolues, en particulier la relation avec la Russie, dont le régime bolchevique n’était pas encore consolidé.
Après Versailles
D’autres dossiers ne furent solutionnés que postérieurement. Le traité du 4 juin 1920 amputa la Hongrie des deux tiers de son territoire. La raideur actuelle de ses dirigeants peut s’expliquer partiellement par l’injustice dont elle fut alors victime. Le sort de la Turquie, défavorablement traitée le 10 août 1920, fut remis en cause en 1923 dans un sens pour elle plus favorable, puisque supprimant la promesse d’États arménien et kurde. On rejoint là aussi les problèmes actuels.
Le jugement de l’Histoire sur le traité de Versailles et ses suites, plutôt négatif, mérite davantage d’équanimité selon l’auteur. Il jetait les bases d’un ordre mondial dont on ne pouvait, a priori, préjuger l’échec. Mais il a, vis-à-vis de l’opinion publique allemande, porté en son sein les germes qui allaient empoisonner l’atmosphère européenne. La culpabilité attribuée à l’Allemagne seule semble aujourd’hui abusive mais elle correspondait au sentiment des pays vainqueurs. Le vaincu s’ancra dans le désir de retrouver son statut de grande puissance, motif essentiel du succès de Hitler.
Les dirigeants qui avaient négocié et signé le traité ne furent plus là pour le mettre en œuvre. Les désaccords ultérieurs entre leurs successeurs pour son application l’affaiblirent considérablement. Mais surtout, du côté français, on pensait avoir renoué avec la gloire napoléonienne alors que se cachaient en réalité le début de notre déclin, la fin de notre grandeur. Toutefois, ce constat n’était pas facile à émettre à l’époque.
L’ouvrage de Jacques-Alain de Sédouy décrit bien l’écart entre les raisonnements du moment et les réflexions qui s’imposent un siècle plus tard. Les notes et cartes géographiques aident à suivre les étapes de négociations complexes où se sont entremêlés rapports de forces et psychologie des peuples.
Raymond Krakovitch
