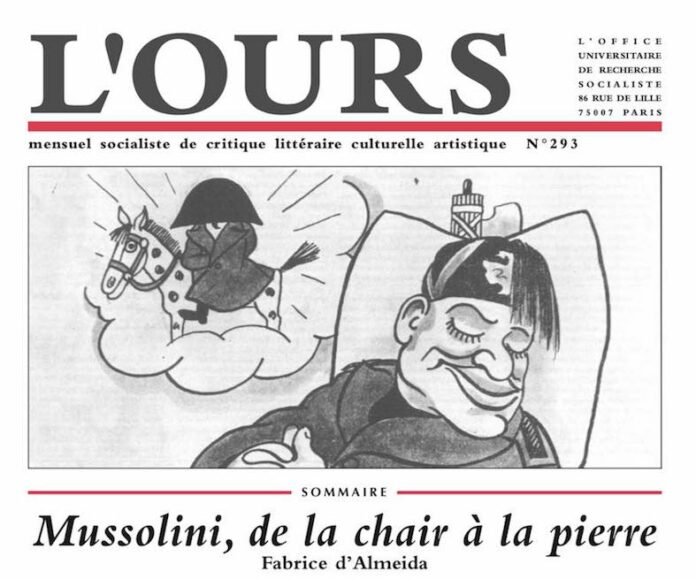À l’occasion de la sortie en format poche (Pluriel/Fayard) de l’incontournable biographie de Mussolini par Pierre Milza (1932-2018), nous republions l’article paru dans L’OURS au moment de sa sortie.
La biographie de Mussolini se confond avec l’histoire de l’Italie contemporaine, disait l’antifasciste Piero Gobetti en 1924. Pierre Milza démontre la vérité de cette affirmation. Son immense biographie de Mussolini n’est pas un simple livre sur la vie d’un dictateur. Elle recouvre un projet d’histoire totale de l’Italie dans la première moitié du siècle qui s’achève. On y trouve donc des passages intimes et une réflexion sur la société italienne. (a/s de Pierre Milza, Mussolini, Fayard, Pluriel Histoire, 2025, 985p, 19,90€)
La lecture de ce livre, dont la préparation s’est étalée sur plus d’une décennie, résout plusieurs débats posés ces dernières années à l’historiographie, en particulier sous la plume virulente de l’autre spécialiste du Duce qu’était le regretté Renzo De Felice. Allons directement à ces questions pour rassurer le public sur l’absence de complaisance de l’historien pour cet étrange objet d’étude qu’est Benito Mussolini. Trois questions, trois réponses sans équivoque de Pierre Milza : – Mussolini a-t-il mis en place un régime totalitaire ? Oui, la dictature installée dès 1922 se raidit progressivement et possède toutes les caractéristiques des régimes totalitaires dans les années trente. – Mussolini a-t-il accompli un génocide en Ethiopie alors que la victoire militaire était acquise ? Oui, il a même utilisé des armes chimiques indifféremment contre les militaires et les civils. – Mussolini a-t-il favorisé une politique raciale avant les lois de 1938 ? Oui, dès 1936 une tendance raciste est manifeste, à l’égard des noirs, en relation avec l’Ethiopie, mais s’amorce aussi le retournement antisémite.
Entre Benito et le Duce
Mais là ne réside pas selon nous le mérite de l’ouvrage. Il tient davantage dans le subtil dosage de réflexion sur une personnalité et sur une époque. Mussolini, chacun le sait, vient d’une famille bourgeoise, « prolétarisée », dont le père a embrassé précocement la cause du socialisme. Il est le dépositaire du drapeau rouge de sa section et Benito enfant se souvient de ces cérémonies presque ésotériques qui voyaient les militants se réunir dans la cave de l’auberge paternelle et baiser les plis de ce fragile symbole avant de se séparer. Devenu instituteur puis émigré en Suisse, il retrouve les traces paternelles. Il milite dans le PSI de la Belle époque et crée une tendance avec les syndicalistes révolutionnaires, qui lui vaut de devenir le directeur du journal du parti, l’Avanti !, peu avant la Première Guerre mondiale. La guerre modifie la donne. Contre la majorité pacifiste du PSI, il fait campagne pour l’entrée en guerre dans un nouveau journal, son journal, le Popolo d’Italia. Finie la période rouge, début de la période noire qui l’amène au pouvoir après l’extraordinaire coup de bluff de la marche sur Rome (les troupes royales supérieures en nombre et mieux armées auraient pu détruire ces bandes factieuses). On connaît la suite de cette histoire. Mythifiée, elle fut l’objet d’une sorte de culte national. Pierre Milza la rappelle en soulignant comment les questions diplomatiques sont au cœur du gouvernement fasciste, trop souvent limité à sa pensée « sociale ». Surtout, il s’appuie sur des travaux récents et varie les angles d’attaque pour montrer comment s’est construite la statue du Duce. Mussolini est soucieux de son image. Il la soigne, recherche les effets vestimentaires, abandonnant progressivement le costume civil pour l’uniforme après 1927. Il sait poser pour les photographes. Il a l’habileté de choisir les hommes qui travailleront à sa seule gloire.
L’ordinaire d’un chef de bande
L’homme a quelque chose du chef de gang. Il surveille ses hiérarques. Les récompense ou les punit pour qu’ils assument la fonction qu’il attend d’eux. Il promeut ses proches, sa famille, ses maîtresses. Autour de lui le jeu des faveurs rappelle les univers courtisans les plus corrompus. La pérennisation de son pouvoir accentue ces logiques abjectes. Le Romagnol est aussi superstitieux. Il a une sorte de fétichisme pour les objets qui l’ont accompagnés dans sa vie : il hésite à changer de chapeau, à renoncer aux guêtres. Pathétique et puéril, il est aussi généreux par rapport à certains anciens opposants-amis. A Pietro Nenni, le leader socialiste, il ne fera pas de mal (les Rosselli, plus jeunes, n’auront pas la même chance). A la famille de Matteotti, il fait verser des subsides afin de maintenir leur fortune et leur rang, trouvant dans cet acte la meilleure justification de son innocence dans l’assassinat du père. Ce qui se joue ici n’est pas de la « petite histoire » mais plutôt une histoire politique sensible aux nouveaux développements de l’histoire des signes et des représentations. La dimension symbolique obsède le Duce et son biographe suit cette inflexion pour comprendre la mécanique d’un pouvoir omniprésent. Car si Mussolini est au centre du système, la machinerie tourne à merveille. Pierre Milza montre l’action du parti, celle des fonctionnaires. Il restitue le rôle du roi dans ce processus : la concurrence est patente ; le souverain patiente ; il veut retrouver le devant de la scène. La querelle entre fonctionnalistes et intentionalistes paraît dérisoire au vu des documents rapportés. Bien sûr les hiérarques pourraient gouverner sans Mussolini. Mais celui-ci est leur référence. En fin de parcours seulement, l’homme paraît vidé et creux. Le système ne résonne plus à travers lui. Il suit les événements qui le conduisent, sans qu’il s’en doute, à une issue terrible.
Entre le penseur et le jouisseur
Le travail est colossal. La lecture agréable. Le style vivant. Le sujet passionnant. Le lecteur curieux d’histoire du socialisme sera satisfait par les pages consacrées à la jeunesse de Mussolini. Sa description est en effet l’occasion pour Pierre Milza de brosser un tableau du socialisme des années 1880 jusqu’à la dissolution des partis en 1925. Mussolini possède cette culture : Labriola, Mondolfo, Ferri… Il est moins marxiste que sorélien. Il tempère la culture classiste par la lecture de philosophes qui fondent leur réflexion sur les élites. Il interprète Pareto et Mosca. Il n’a le culte du peuple que pour régénérer une Italie libérale jugée vieillie. De là sa croyance vitaliste en la jeunesse, son éthique du combat, son approche de la violence comme d’une nécessité, son obsession pour le travail et l’action. L’homme a aussi ses limites. Timide, il hésite parfois. Devant les femmes notamment qui jouent un rôle primordial dans la première partie de son existence ; jeune homme il a commis un viol. Il s’en vantera, pensant avoir prouvé sa virilité. Au soir de sa vie, devant le peloton d’exécution, c’est encore une femme qui tente de le réconforter avant d’être mitraillée à son tour. Celle-là n’a rien d’une doctrinaire. Elle accomplit son devoir de courtisane. Le lecteur regrette presque la cruauté du temps pour Claretta Petacci. Elle n’aura pas de réponse à son ultime demande : « Tu es content que je t’ai suivi jusqu’au bout ? »
Fabrice d’Almeida
Article paru dans L’ours n°293 décembre 1999