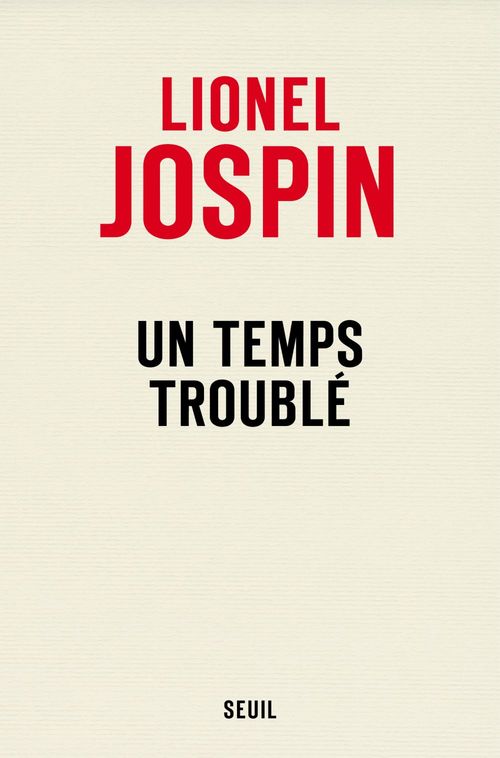L’ouvrage de Lionel Jospin arrive après des années de silence. Elles sont dues au devoir de réserve qu’imposait son appartenance au Conseil constitutionnel – et, peut être aussi, à sa réticence à intervenir sur les politiques menées. Nous sommes, aujourd’hui, dans un autre temps. Celui des « inventaires », en quelque sorte…
L’ancien premier secrétaire a le sentiment que nous sommes à un « tournant », pas seulement pour les socialistes, mais pour le pays et le monde. Comprendre l’enchevêtrement des problèmes qui caractérise notre situation est le propos de ce livre. Et nous retrouvons les qualités que nous connaissons de l’auteur, le goût de l’analyse, une plume ferme, des jugements clairs. Bien sûr, Lionel Jospin a, aussi, le souci de rappeler son action passée, tout particulièrement dans le « quinquennat » de la cohabitation de 1997 à 2002, pour en faire un point de référence. L’inventaire ne peut donc s’appliquer qu’à une période plus longue que notre actualité proche. Et c’est heureux, car l’histoire facilite la mise en perspective des événements et des faits. Quatre parties structurent le livre, une analyse des causes et des conséquences des élections de 2017, un diagnostic sur la situation politique présente, la mise en évidence des trois grands défis qui sont les nôtres, une réflexion, enfin, sur ce que révèle et entraîne la crise sanitaire actuelle. Chaque partie appelle, comme il est naturel, des questions pour le lecteur.
Questions sur un diagnostic
Lionel Jospin a raison de souligner le poids de la conjoncture dans les résultats de 2017, l’affaiblissement de François Fillon, empêtré dans ses affaires, a facilité l’accession d’Emmanuel Macron au second tour. Mais les déséquilibres, insiste-t-il, viennent de plus loin. Il les date, un peu curieusement, de 1995 avec, il est vrai, à l’esprit les divisions de la droite. 1993, avec la lourde défaite socialiste, qui est évoquée plus loin dans le livre, est aussi un facteur de crise, cette fois à gauche. L’ancien Premier ministre attribue, pour l’essentiel, l’échec de 2002 à la division de la gauche après, pourtant, cinq années de gouvernement au bilan plus qu’honorable. C’est arithmétiquement exact. Mais ses causes méritent examen, elles tiennent aussi à des choix faits dans la préparation et dans le feu de la campagne présidentielle. La victoire législative de 1997 n’avait pas effacé non plus les fragilités d’un électorat toujours à reconstituer d’élection en élection selon le enjeux, où la « synthèse » entre les classes moyennes et les classes populaires n’avait rien d’évident. La crise socialiste, cependant, a éclaté dans les années 2012-2017. Certes, Lionel Jospin indique des réussites dans les politiques des gouvernements de François Hollande, face aux attentats de 2015, dans des initiatives de politique étrangère, dans les débuts d’un redressement économique arrivé trop tardivement. Mais il souligne trois difficultés majeures : « un défaut d’autorité », « une absence de solidarité », « la désagrégation de l’identité politique ». La responsabilité des « frondeurs », qui n’ont pas mesuré les conséquences de la scission larvée qu’ils ont conduite, est pointée. Plus graves, cependant, ont été la mauvaise appréhension de la proposition de la « déchéance de nationalité » pour les binationaux convaincus de terrorisme et la priorité donnée à la « politique de l’offre » – sous l’influence d’Emmanuel Macron, est-il suggéré… – avec, ensuite, la réforme conflictuelle du marché du travail qui en a découlé en 2016. Les fractures militantes et électorales induites expliquent, pour l’essentiel, l’échec de la primaire socialiste et le désastre socialiste lors des élections présidentielle et législatives.
Il est intéressant de noter que Lionel Jospin consacre un chapitre à revenir sur ce qui lui a été, parfois, reproché à savoir l’instauration du quinquennat et l’inversion du calendrier pour les élections législatives. Les institutions, pour lui, ne sont pas une des causes de la crise qui tient, avant tout, aux politiques suivies. Il fallait simplement revenir au fonctionnement normal de la Ve République – ce qui n’était pas, il faut le remarquer, la position des socialistes qui se prononçaient, dans leurs programmes, pour une parlementarisation du régime.
Le macronisme en question
Les développements sur le « macronisme » s’enchaînent directement avec ces analyses. Le diagnostic est sévère. Sans dénier quelques qualités au nouveau président, l’ancien Premier ministre voit l’application, jusqu’à aujourd’hui, d’une politique d’inspiration néo-libérale, avec la diminution de la progressivité de l’impôt, la suppression des « contrats aidés », la dérégulation du marché du travail etc. Jusqu’à aujourd’hui, parce que l’ampleur de la crise économique actuelle depuis le confinement, et qui concerne le monde entier d’une manière ou d’une autre, interdit (provisoirement ?) ce type de politiques et réhabilite, au contraire, la dépense publique. Lionel Jospin pense, néanmoins, que le « logiciel » macroniste est paradoxalement « archaïque », pour celui qui voulait incarner un monde nouveau, car le néo-libéralisme était entré en crise avant même l’expansion du Coronavirus. Sa critique s’étend à la méthode et au style de gouvernement d’Emmanuel Macron, qui cultive la « verticalité » et qui récolte le conflit, en aggravant les divisions de la société française. Tous les exemples sont présents à l’esprit. Ce qui permet à l’auteur de caractériser, finalement, l’idéologie macroniste comme un mélange de néo-libéralisme technocratique et d’un progressisme vague.
Questions sur le libéralisme et le socialisme
Ce tableau d’ensemble offre un cadre d’explication, qui n’est pas à prendre ou à laisser, mais veut appeler les réflexions des lecteurs, particulièrement celles et ceux qui ont vécu et vivent cette histoire. Pour ma part, je n’insisterai que sur un point – important, il est vrai – qui concerne une bonne part du livre, le rapport au libéralisme. Que l’opposition entre le libéralisme et le socialisme, comme le marque Lionel Jospin, soit principielle, c’est une évidence philosophique et historique, le premier se fondant sur le primat de l’individu, le second sur celui du collectif, ou plutôt de l’association, comme le disaient les socialistes dits « utopiques » au XIXe siècle. Mais les socialistes, quand ils se sont voulus pleinement démocratiques, faisant ainsi leur le pluralisme dans la société, ont revendiqué une grande part de l’héritage du libéralisme, l’État de droit, les libertés civiles, une économie de marché encadrée, et ils y ont ajouté l’État-Providence sous des formes variées. Au fil du temps, les libéraux et les socialistes, souvent dans la confrontation politique et sociale, ont réalisé une adaptation de leurs principes initiaux pour forger les sociétés que nous connaissons en Europe, qui sont, à des degrés divers, des régimes mixtes, même aujourd’hui malgré les assauts du néo-libéralisme.
Le socialisme démocratique veut arriver à un équilibre entre l’individu et le collectif, l’efficacité économique et la justice sociale. Ce sont, bien sûr, des situations changeantes, et qui dépendent des rapports de force plus ou moins favorables. C’est tout cela qu’exprime la formule connue de Lionel Jospin, qu’il ne reprend pas dans son livre, « Oui à l’économie de marché, non à la société de marché ». On peut mettre en cause cette tradition – elle l’a été et l’est toujours – mais il faut la reconnaître. C’est pour cela que l’identité socialiste ne peut pas se définir que par une opposition au libéralisme – et, concrètement, par une condamnation des « politiques de l’offre » –, ces politiques qui ont été mises en œuvre, à un moment ou un autre, par les gouvernements socialistes depuis 1983 en France et, partout en Europe, sans qu’elles résument l’ensemble de leurs politiques, les droits sociaux progressant parallèlement, y compris dans le précédent quinquennat. Faute de s’expliquer clairement, le socialisme français a nourri sa crise idéologique, se condamnant à ne pas mener les batailles culturelles nécessaires et à vivre de douloureux « exercices » du pouvoir.
Questions sur le rapport des forces
La troisième partie du livre caractérise les forces politiques en présence actuellement. Les élections municipales viennent de rappeler qu’il existe une gauche et une droite. Mais aucun parti politique ne présente aujourd’hui une situation stable. Les Républicains n’ont pas retrouvé de doctrine propre, et demeurent, de fait, écartelés. La gauche n’a pas de ciment commun. Pour l’ancien premier secrétaire, le mouvement Génération.s aura une existence éphémère. Le Parti communiste, malgré les qualités de ses militants, est le « témoin » d’un passé politique qui ne peut revenir. La « radicalité de Jean Luc Mélenchon » n’effraye pas Lionel Jospin. Mais les pages qui sont consacrées à La France insoumise – plus que dans les interviews de presse – vont au-delà de la critique d’un style fait de « bruit et de fureur » pour récuser l’idéologie populiste revendiquée et théorisée et pour s’inquiéter des conséquences d’un programme qui débouche sur « l’inconnu ». Il n’est pas étonnant que Lionel Jospin consacre un long développement au Parti socialiste. Il ne cache pas ses dysfonctionnements passés. La reformulation d’une identité forte lui semble essentielle. Il faut, évidemment, y intégrer pleinement l’écologie. C’est un travail difficile qu’il juge cependant possible, à condition de faire preuve de solidarité et d’y mettre de « l’éclat ». Alors, des alliances équilibrés pourront se forger à gauche avec les écologistes. Ce qu’il faut éviter à tout prix pour l’avenir politique du pays, c’est un face à face « périlleux » entre La République en Marche et le Rassemblement national. « Périlleux », car la LRM est un mouvement faible, sans vie démocratique, qui tient à un homme, susceptible de se dissoudre dans l’échec. Malgré sa médiocrité, le RN, parti de la « droite extrême », pourrait bénéficier d’une conjoncture hasardeuse.
Quel programme pour la gauche ?
Dans la dernière partie du livre, Lionel Jospin se livre, en quelque sorte, à un travail programmatique pour la gauche. Dans la tradition des grands rapports politiques, il part d’une analyse géopolitique pour insister sur les fragilités de la démocratie et sa nécessaire défense face à la progression des « despotismes », sous une forme ou une autre, dans le monde. Ce qui lui permet de revenir sur les phénomènes populistes – et ce n’est pas étonnant qu’il le fasse dans ce chapitre. La question des migrations, ensuite, pose en fait le problème des États et des communautés nationales. C’est une ancienne préoccupation de l’ancien Premier ministre de proposer des politiques lucides dans le respect du droit. Il détaille, de manière convaincante, ce que doit être une politique d’intégration républicaine. Il consacre sa troisième réflexion à l’écologie évidemment, mais aussi à ce qui menace la vie sur la terre, les évolutions démographiques, le danger de trop fortes inégalités. Lionel Jospin insiste sur la nécessité d’aller vers une transformation de notre système productif mais, en même temps, si nous osons dire… il manifeste sa confiance dans l’innovation technologique. Ces trois défis lus ensemble permettent de retrouver une constante de la pensée (et de l’action) de Lionel Jospin, la recherche d’équilibres pertinents dans des réalités complexes. La postface sur la crise sanitaire est écrite avec le même souci.
Ce compte rendu, déjà long – et il aurait pu l’être davantage ! – montre l’intérêt que les lecteurs – évidemment les socialistes présents et passés – peuvent éprouver à la lecture de cet ouvrage dans une période faite de plus d’interrogations que de certitudes.
Alain Bergounioux