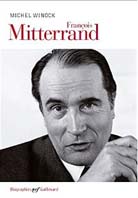2016 verra le centenaire de la naissance de François Mitterrand. De nouvelles publications et manifestations seront consacrées à la vie et à l’action d’une personnalité politique qui a marqué l’histoire de notre pays dans l’esprit des Français au cours du siècle dernier.
Ce n’est évidemment pas fortuit que les deux présidents qui viennent en tête dans toutes les enquêtes d’opinion sont De Gaulle et François Mitterrand – ce dernier s’étant posé comme l’adversaire privilégié du premier président de la Ve République. Michel Winock inaugure la vague commémorative, et de belle manière.
à propos du livre de Michel Winock, François Mitterrand, Gallimard, 2015, 450 p, 25 €
article paru dans L’OURS 447, avril 2015, page 8.
 La biographie de Michel Winock est, avant tout, une tentative de cerner le sens d’une vie politique et la portée d’une action. Elle n’apporte pas, à proprement parler, de connaissances neuves. Elle réalise, en revanche, une synthèse maîtrisée des nombreux travaux et essais déjà parus. Une de ses forces – comme l’auteur l’avait montré dans ses précédentes biographies – est de ne pas séparer l’homme privé de l’homme public. Bien des choix politiques, en effet, s’éclairent par les caractères et les visions de l’homme et de la société forgées dans les années de jeunesse. C’est particulièrement vrai pour François Mitterrand.
La biographie de Michel Winock est, avant tout, une tentative de cerner le sens d’une vie politique et la portée d’une action. Elle n’apporte pas, à proprement parler, de connaissances neuves. Elle réalise, en revanche, une synthèse maîtrisée des nombreux travaux et essais déjà parus. Une de ses forces – comme l’auteur l’avait montré dans ses précédentes biographies – est de ne pas séparer l’homme privé de l’homme public. Bien des choix politiques, en effet, s’éclairent par les caractères et les visions de l’homme et de la société forgées dans les années de jeunesse. C’est particulièrement vrai pour François Mitterrand.
Une jeunesse à droite
« Une enfance barrésienne », dit Michel Winock. Sans doute, pour la génération née avec la Grande Guerre, l’auteur de La colline inspirée, qui avait laissé la place au chantre du nationalisme, n’a-t-il pas eu la même influence que pour celle des années 1880. En revanche, il est clair qu’une éducation catholique, dans une droite provinciale attachée aux traditions, a eu une influence certaine. Les reconstructions faites a posteriori ne peuvent cacher que le jeune charentais a été un étudiant de droite, adhérent un temps au Parti social français du colonel de La Rocque, fort peu sensible aux manifestations du Front populaire et fort critique vis-à-vis du régime parlementaire. Il n’est donc pas étonnant qu’évadé d’Allemagne en décembre 1941, il ait été sensible aux perspectives ouvertes par la Révolution nationale et qu’il ait pensé que le maréchal Pétain était la figure autour de laquelle une nouvelle génération politique pouvait s’atteler à la reconstruction du pays. Mais, et Michel Winock le montre bien, le jeune François Mitterrand n’était pas un « collaborateur ». Il était, au contraire, profondément patriote. Et, comme d’autres, il a glissé vers la Résistance à la fin de l’année 1942, entrant ainsi dans la catégorie de « vichysto-résistants », bien étudiée récemment – et ce d’autant plus que plusieurs idées de la Révolution nationale se retrouvaient dans les réseaux de la Résistance. La détermination dont il fait preuve, le courage qu’il a manifesté, le charisme qui était déjà le sien, expliquent qu’il se soit imposé dans les premiers rangs des responsables sortis de la Résistance en 1944. Malgré le dissentiment qui l’avait opposé au général de Gaulle – sur un conflit de pouvoir déjà ! – il figure dans le gouvernement provisoire de la République française en 1944. Dès lors, il n’a plus quitté l’action politique.
Un réformateur de la Quatrième
Les pages consacrées à la IVe République – où il est « l’éternel ministre » selon le titre d’un chapitre – montrent que François Mitterrand n’a pas trouvé une détermination politique nettement définie avant 1958 – et qu’il en a joué avec habileté. Il a appartenu à un parti charnière d’Union démocratique et socialiste de la Résistance – où figure la notion de socialisme – mais il a pris position contre le « tripartisme » et il a conquis son fief dans la Nièvre contre la SFIO. L’évolution de la vie politique – et particulièrement sa lutte au sein de l’UDSR contre René Pleven – l’a amené à prendre un positionnement de « centre-gauche », comme l’attestent son rôle dans les gouvernements de Pierre Mendès France et de Guy Mollet. Sa confrontation avec le système colonial a fait de lui, cependant, un réformateur prudent, qui a pris ses responsabilités en démissionnant au moment de la déposition du Sultan du Maroc, en 1952, mais qui n’a pas fait part de ses désaccords autrement qu’au sein du gouvernement en 1956 et 1957, couvrant ainsi, comme ministre de la justice, la politique menée en Algérie. Il est vrai qu’au cœur du jeu parlementaire de la IVe République, possible président du Conseil, il entendait ménager l’avenir.
C’est l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle, en 1958, sur les ailes de la menace militaire, qui a décidé du sens de son engagement politique. Opposé au coup d’État, il s’est d’emblée posé en représentant de la tradition républicaine contre le nouveau régime. Son intelligence politique a été de comprendre, avant beaucoup, que les nouvelles institutions, tout particulièrement, après 1962 avec l’élection du président de la République au suffrage universel, instituaient une dynamique politique binaire qui demandait que la gauche se rassemblât et qu’un accord fut trouvé avec le Parti communiste.
En phase avec la gauche
L’histoire des années 1960 est bien connue. Elle a été fort loin d’être linéaire et les traverses n’ont pas manqué. 1965, avec l’élection présidentielle, en constitue évidemment le tournant. François Mitterrand, alors qu’il pesait peu dans la gauche, avec sa petite organisation, la Convention des institutions républicaines, a pris un risque, en se présentant, devant ce qui paraissait devoir être une défaite dans le premier tour, mais il eut aussi sa chance. La légitimité acquise, alors, face au général de Gaulle, par sa seule présence au second tour, lui servit de « viatique » pour tout le reste de son action politique.
Le récit qui a mené à la constitution du Parti socialiste d’Épinay, après la « panne » de 1968, puis à la victoire de 1981 est bien maîtrisé et n’a nul besoin d’être rappelé. Michel Winock met en évidence les qualités politiques de François Mitterrand, son sens tactique et sa vision stratégique, tout particulièrement dans le double conflit qu’il eut à assumer, dans les années 1970, avec le Parti communiste à l’extérieur, et avec Michel Rocard à l’intérieur. Il aurait fallu, cependant, mettre plus l’accent sur les conditions somme toutes favorables dont il a bénéficiées. Les tendances profondes de la société française étaient, en effet, favorables à la gauche. Cela explique que les échecs politiques n’aient été que momentanés et les reconstructions rapides. François Mitterrand a su tirer parti des erreurs de la direction communiste. Mais le Parti communiste avait perdu de sa puissance. Mai 1968 l’avait mis en porte-à-faux dans la société française, ses « bastions ouvriers » s’érodaient et le discrédit de l’URSS était prononcé. C’est, donc, un ensemble complexe qu’il faut prendre en considération.
La dernière partie sur les années de pouvoir résume bien tous les paradoxes à l’œuvre dans l’histoire politique du premier président socialiste de la Ve République. François Mitterrand n’aurait pas accepté le titre du chapitre que Michel Winock donne à l’analyse des politiques suivies sous sa responsabilité, « L’adieu au socialisme ». Car, pour lui, il n’y avait pas eu de « tournant de la rigueur ». Il a dit et redit qu’il a mené une politique qui, après des réformes annoncées dans ses « 110 propositions », cédait nécessairement la place à une période de gestion. Ce n’est pas l’avis des observateurs tant, en 1983, il ne s’est pas agi seulement d’une politique de rigueur budgétaire, mais d’une vraie adaptation à la mondialisation libérale de l’économie française – sans, il est vrai que furent remises en cause les réformes sociales initiales. Mais Michel Winock fournit la réponse : pour François Mitterrand, son socialisme était avant tout un républicanisme social, soucieux de préserver l’influence de l’État. C’est pour cela, également, que François Mitterrand n’a pas vu la nécessité – en dehors des difficultés proprement politiques de « sortir de l’ambiguïté » – de pratiquer l’adaptation idéologique et programmatique que demandait, entre autres, Michel Rocard. Son grand dessein de « substitution » en quelque sorte fut le renforcement de la construction européenne. Il y a vu une chance pour la France, pour mener les politiques qu’elle ne pouvait plus mener seule, et pour l’Europe elle-même qui, au grand vent de l’effondrement de l’URSS et de la réunification allemande, devait y trouver un équilibre politique et une garantie de paix. Si les faits sont bien rappelés et le sens de l’action de François Mitterrand exactement soulignés, le lecteur aurait souhaité sans doute une partie plus étoffée pour tenter d’aller plus loin dans l’analyse du « pari » – pour reprendre l’expression de Jean-Pierre Chevènement – qu’a représenté ce qui est, incontestablement, le legs majeur de François Mitterrand au destin français, si discuté aujourd’hui. Il est, évidemment, important de noter également – et certains analystes politiques insistent sur ce point, que son autre décision majeure a été de conserver les institutions de la Ve République, critiquées pourtant par la gauche, corrigées, il est vrai de la décentralisation. Ce paradoxe – quelque peu empreint de cynisme, puisque, disait-il, « les institutions étaient dangereuses avant moi, elles le seront après moi » – trouve sa raison dans les ressources qu’elles apportaient à la gauche socialiste, pour exercer de pouvoir dans la durée, comme l’a bien démontré la première cohabitation de 1986 à 1988.
Ces éléments de réflexion n’épuisent évidemment pas tout ce que suggère le livre de Michel Winock. Sur une action inséparable d’un demi-siècle de vie politique, et menée au plus haut niveau après 1964, il est naturel de s’interroger, à la fois, sur un bilan historique et sur la nature même de la politique. Le biographe est à la hauteur de son personnage. Précieuses sont les dernières pages du livre, où il rappelle ce qu’ont été les appréciations divergentes sur le rôle de François Mitterrand, faisant ainsi entrer le lecteur dans une discussion rétrospective passionnante.
Alain Bergounioux