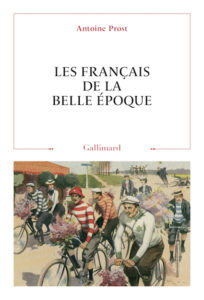 Le souvenir mythifié de la société française, de la fin du XIXe siècle à la Grande Guerre, a suscité le souhait d’un retour à cette période, jusqu’à la fin des années 1920, avant que l’expression de « Belle Époque » n’apparaisse deux décennies plus tard. Au-delà des représentations mémorielles collectives, qu’en fut-il dans la réalité ? Antoine Prost répond avec précision et érudition. (Antoine Prost, Les Français de la Belle Époque, Gallimard, 2019, 384p, 22€)
Le souvenir mythifié de la société française, de la fin du XIXe siècle à la Grande Guerre, a suscité le souhait d’un retour à cette période, jusqu’à la fin des années 1920, avant que l’expression de « Belle Époque » n’apparaisse deux décennies plus tard. Au-delà des représentations mémorielles collectives, qu’en fut-il dans la réalité ? Antoine Prost répond avec précision et érudition. (Antoine Prost, Les Français de la Belle Époque, Gallimard, 2019, 384p, 22€)
Article publié dans L’OURS 497, avril 2020.
Une somme considérable de recherches a été faite sur l’histoire de notre pays durant les deux décennies avant la Grande Guerre mais son tableau général restait à écrire. Organisé en dix chapitres, ce livre comble cette lacune. On ne peut en présenter ici toute la richesse : nous en décrirons les grandes lignes en mettant l’accent sur ce qui concerne le mouvement ouvrier.
Forte de 40 millions d’habitants, la France de la Belle Époque totalisait 17 millions d’actifs appartenant aux classes populaires. Une toute petite minorité imprégnée des valeurs aristocratiques détenait l’essentiel de la richesse nationale ; de son côté, l’immense majorité des pauvres n’avait rien. La France était une société en majorité rurale dans laquelle le franc était stable depuis un siècle. La classe moyenne était faible mais progressait lentement. Un fossé séparait les élites et le peuple. Ce dernier, qui avait une espérance de vie inférieure à 50 ans, ne parlait pas d’emploi mais cherchait du travail ou des places ; de leur côté, les membres de l’élite obtenaient une situation ou une position. Comme l’écrit Antoine Prost « l’immense majorité des Français ne vivaient pas une époque belle ».
Cette période qui a laissé un souvenir radieux fut dure et violente. La journée de travail – 10 heures – était longue, et les conditions de vie difficiles pour la plupart des Français. La question religieuse perdit de son acuité avec la loi de 1905 mais le cessez-le-feu qui la suivit laissa les antagonismes intacts. Des divisions existaient également au sujet de la question nationale et militaire entre les défenseurs de l’armée, du patriotisme et des conquêtes coloniales, et la gauche antimilitariste acquise à l’internationalisme prolétarien pacifiste et hostile, sinon à la colonisation, du moins à ses méthodes. Ces divisions recoupaient largement la fracture sociale qui n’opposait pas seulement des intérêts mais aussi des valeurs entre ceux qui croyaient au Grand soir et à la révolution, et ceux qui défendaient l’ordre et la civilisation. Jaurès, dont beaucoup se réclament aujourd’hui, suscita des haines violentes qui menèrent à son assassinat : son meurtrier fut acquitté cinq ans plus tard.
Ouvriers et paysans
Dans cette France rurale, la séparation entre ouvriers et paysans restait floue. Les grèves dirigées par les syndicalistes contre le patronat étaient le plus souvent violentes ; certaines étaient toutefois tempérées par l’action des préfets. Elles étaient parfois des moments de fêtes, inspirées par d’anciennes traditions carnavalesques. Elles étaient enfin souvent une affaire d’honneur : se désolidariser d’une grève, c’était courir le risque de se voir traiter de lâche et de traître. Ces grèves ne se limitaient donc pas aux revendications pour des conditions de travail un peu moins dures et de meilleurs salaires : elles étaient bien davantage et le militant syndical « était un mixte du héros et du saint, un homme intègre, fort courageux, résolu, dévoué ». La proximité entre paysans et ouvriers explique, selon Antoine Prost, la volonté d’indépendance, ancienne pour le monde rural et partagée avec le syndicalisme naissant, vis-à-vis de l’État et des partis politiques : pour les syndicalistes, cette indépendance était symbolisée par la Charte d’Amiens (1906), réponse à la création de la SFIO l’année précédente. Mais quatre ans plus tard, avec au mieux 450 000 adhérents, la CGT restait très minoritaire.
Peut-être pourrait-on ajouter que le souvenir de la répression des révoltes ouvrières du XIXe siècle – les Canuts, les journées de juin 1848 à Paris et la Commune – avait produit une culture de méfiance des premiers syndicalistes à l’égard de l’État. Jusqu’à la Grande Guerre, la CGT se construisit d’abord contre lui. L’État poursuivait sa politique répressive mais il s’investissait aussi peu à peu dans le social à travers des hommes comme Waldeck-Rousseau et Millerand. Cette politique ne fut guère comprise, comme le montre la campagne de la CGT contre la loi de 1910 sur les Retraites ouvrières et paysannes, ces « retraites pour les morts ». La paysannerie, l’Église, les économistes et la mutualité s’opposèrent aussi à cette réforme : l’idée que l’État puisse intervenir dans le social restait minoritaire chez les Français.
Un vent d’optimisme
Pourtant, la Belle Époque fut aussi une période où beaucoup crurent au progrès et, dans une certaine mesure, le vécurent. Cet optimisme apparaît dans les programmes – très différents – défendus alors par les partis politiques et les syndicalistes, ainsi que les mutualistes et les coopérateurs. Nous le savons aujourd’hui, cet état d’esprit n’était pas dénué d’illusions mais qui pouvait alors l’imaginer ? Et la majorité des Français voyait une amélioration de ses contions de vie ; cette évolution a été confirmée par les recherches ultérieures. Pour le plus grand nombre, la vie était moins dure que deux décennies plus tôt, et ils le ressentaient dans leur vie quotidienne à travers une diversification de leur alimentation, une réduction du temps passé à travailler et un budget qui s’ouvrait peu à peu aux loisirs, au sport et à la culture.
Seule République en Europe, la France était considérée de façon condescendante par l’Allemagne comme un pays décadent, vieillissant et qui, par son régime politique, avait renoncé aux principes d’ordre, de civilisation et de tradition sur lequel reposaient les nations fortes. La famille et les liens de solidarité occupaient encore une grande place dans la société française qui s’engageait timidement dans une politique sociale menée par l’État. Cette société était pourtant bien plus solide que ne croyait l’ennemi héréditaire car la République s’était enracinée depuis quatre décennies. Elle était un régime de progrès et elle méritait qu’on la défendit : on le vit bien en 1914 ou l’union sacrée et l’entrée de socialistes symbolisèrent l’unité de la Nation et l’unicité de la République.
Avec cette belle synthèse, Antoine Prost, au-delà de la nostalgie et du mythe, permet de comprendre ce que ce fut vraiment ce « monde d’hier », aujourd’hui disparu.
Michel Dreyfus
