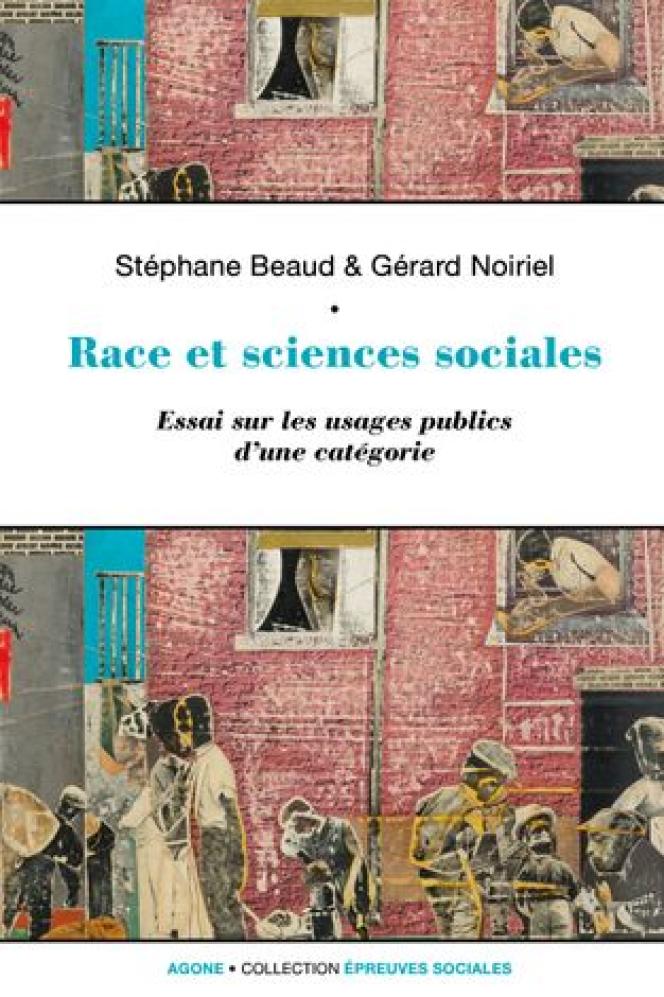Est-il fondé de penser que la question de la « race » et, avec elle, les effets durables du colonialisme et, plus largement encore, les revendications identitaires, constituent la clef de lecture principale pour comprendre les phénomènes actuels de domination ? Est-il juste d’en faire les combats prioritaires pour les gauches ?
à propos du livre de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d’une catégorie, Agone, 2021, 422p, 22€.
Article paru dans L’ours 509, juin 2021.
La parution de ce livre provoque un débat au-delà des cercles universitaires. Car il pose deux questions, l’une d’ordre scientifique, concernant ce que doit être la bonne lecture de la société contemporaine, l’autre d’ordre politique, portant sur ce que doivent être les responsabilités de la gauche aujourd’hui (ou plutôt des gauches). Celles-ci sont liées en fait, les deux auteurs aussi bien revendiquant une conception de leur métier, d’historien pour Gérard Noiriel, de sociologue pour Stéphane Beaud, comme devant apporter une compréhension exacte de la réalité pour permettre de mener un combat politique pertinent.
Pour y répondre, les auteurs procèdent en trois temps. Une première partie redonne une perspective historique depuis la fin du XIXe siècle, pour montrer l’enjeu qu’a déjà représenté la notions de race dans les luttes politiques et idéologiques. La seconde étudie le moment présent où la « race » paraît l’emporter sur la « classe ». Et la troisième décortique, en quelque sorte, une étude de cas sur l’affaire dite des « quotas raciaux » dans le football français en 2011.
Les enjeux d’une notion
Reprenons les enseignements principaux de chacun de ces développements. Par le terme de race, les hommes du XVIIIe siècle entendaient principalement désigner des espèces humaines différentes. La cristallisation de la notion moderne s’est faite avec l’affirmation des nations et la formation d’un « nous national ». Parallèlement, l’importance prise par l’anthropologie médicale a donné une interprétation biologique qui a exercé une forte influence dans les débats. Mais, Gérard Noiriel insiste à juste titre sur le tournant qu’a représenté pour la France la guerre de 1870 et ses conséquences. Face à la conception allemande de la race, la France de la IIIe République va insister, principalement, sur l’aspect civilisationnel de la définition de la race. La fameuse conférence de Renan, de 1882, est évidemment analysée avec toutes ses ambiguïtés : le « plébiscite de tous les jours » va de pair avec un héritage culturel. L’expansion coloniale contribue évidemment à nourrir un sentiment de supériorité qui explique la revendication, largement répandue, de « la mission civilisatrice de la France ». La montée du nationalisme et de l’antisémitisme ancre la lutte des races dans le combat politique à la fin du XIXe siècle. Ces courants peuvent s’appuyer sur toute une série d’essais et de travaux ouvertement racistes, tels ceux de Vacher de Lapouge ou d’Arthur de Gobineau. Le mouvement socialiste qui prend de l’ampleur, même divisé, et influencé par le marxisme, met en avant la réalité de la lutte des classes et fait du racisme une politique de division de la classe ouvrière entre les mains du patronat et des conservateurs. L’Affaire Dreyfus, évidemment, voit une forte polarisation entre une droite nationaliste et une gauche socialiste internationaliste – même si le terme de race, avec des acceptions différentes, est utilisé dans le vocabulaire courant. Une tension entre la « race » et la « classe » court depuis cette période. Elle atteint un nouveau pic avec la crise des années 1930 et plus encore avec le régime de Vichy où la médecine anthropologique tend à occuper la première place – pensons au renom alors d’Alexis Carrel, par exemple. À la fin de la guerre, au contraire, les conceptions racistes sont discréditées et paraissent emportées avec la défaite de l’Allemagne. La gauche est clairement anti-raciste et se définit, essentiellement, à travers la question sociale – même si les difficultés et les drames de la décolonisation montrent que bien des contradictions demeurent.
La race vs la classe ?
La seconde partie est en prise avec nos débats présents. Elle veut rendre compte du passage d’une « hégémonie » culturelle fondée sur la primauté du social à une autre mettant en avant la question de la race. Mai 1968 avait revivifié, en apparence, le langage de la lutte des classes. Mais, ces années ont vu tout autant s’imposer des revendications identitaires, féministes, au premier chef, pour la défense des homosexuels et des lesbiennes, pour les expressions régionales etc. La défense des travailleurs immigrés, qui a pris la suite du combat anticolonial, a favorisé la montée du « moralisme » dans le discours politique à un moment où, dans les oppositions au sein de la gauche, le Parti socialiste et la CFDT ont voulu s’approprier les valeurs humanistes face à un Parti communiste déclinant, mal à l’aise avec ces nouveaux mouvements sociaux. Mais c’est évidemment, dans les années 1980, l’irruption puis l’affirmation du Front national qui, par le débat sur l’immigration, ont joué un rôle majeur pour refaire de la « race » un enjeu politique.
Les auteurs, pour cette décennie, mettent aussi l’accent sur deux faits majeurs qui ont additionné leurs effets dans ce renversement culturel : d’abord, le choix politique des gouvernements à direction socialiste, de 1982 à 1984, qui ont accepté une logique libérale donnant la priorité à l’économie sur le social ; ensuite, avec l’affaire des foulards de Creil en 1989, la place grandissante prise par l’Islam dans les débats français. Tout ceci s’est accentué dans les décennies suivantes dans un contexte rendu dramatique par le terrorisme d’origine islamiste.
De la « racialisation »
Stéphane Beaud et Gérard Noiriel mettent ainsi en évidence les interprétations à dominante culturelle qui ont été données des émeutes des banlieues, en 2005, aux dépens de toute explication sociale. Cette évolution a été, également, nourrie et confortée par des associations et des mouvements, expressions de militants issus de la population immigrée, tel celui des Indigènes de la République qui portent une « racialisation » des problèmes politiques et sociaux. Les auteurs analysent, dans cette partie, les traductions intellectuelles de cette situation. Ils le font, principalement, à travers la critique de trois ouvrages, celui de Didier et Éric Fassin, De la question sociale à la question raciale (La découverte, 2006), livre collectif auquel ils ont d’ailleurs participé, celui de Pap Ndiaye, La condition noire (Calmann-Lévy, 2008), celui sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaine, La Fracture coloniale (La découverte, 2005), ouvrages qui font des questions identitaires leur grille de lecture.
Enfin, dans la dernière partie du livre sur la question des quotas dans le football en 2011, Stéphane Beaud et Gérard Noiriel veulent démontrer ce que doit être le travail sociologique. La simple accusation de propos racistes tenus au sein de la direction du football français, portée initialement par Mediapart (qui a fortement critiqué ce livre…), cède à la facilité en ignorant les enjeux institutionnels – les règles internationales permettant aux jeunes joueurs, formés dans les centres français de choisir, ensuite, une autre nationalité pour la compétition mondiale et posant, ainsi un problème au football français –, et les réalités sociales – une nouvelle catégorie de joueurs, issue de l’immigration et venant des banlieues, influencée parfois par l’Islam, déstabilise un encadrement plus ancien. Il n’y a pas un racisme institué, mais un ensemble de problèmes sportifs, économiques et sociaux. Il faut, donc, éviter les simplifications faciles et prendre le temps de mener un travail sociologique de terrain.
Identités individuelles et collectives
Stéphane Beaud et Gérard Noiriel ne cachent pas leur conviction, seule une bonne pratique des sciences sociales – la leur – sert un combat utile pour l’émancipation sociale. Quand la question anti-raciste est déconnectée des luttes pour l’égalité économique et sociale, elle « tourne à vide » et divise la gauche. Les auteurs ne nient pas qu’il y ait des problèmes réels. Mais, pour eux, il est décisif de prendre en compte toutes les variables qui constituent les identités individuelles et collectives. Le constat est souvent fait que la dimension sociale est la meilleure clef de compréhension.
Cela dit, les auteurs se donnent quelques facilités. Les chercheurs et intellectuels qu’ils critiquent combinent aussi plusieurs variables, de race, de genre, de classe, pour présenter leurs résultats. Le terme d’« intersectionnalité » ne doit pas être un épouvantail, il y en a plusieurs usages. Ce qu’il faut, c’est éviter le déterminisme qui assigne les individus à une identité et à une seule comme l’avaient fait hier nombre d’intellectuels marxistes avec la « classe ». L’essentialisation menace lorsque l’on mélange, sans la distance nécessaire, la recherche et l’engagement. Les auteurs s’y emploient le plus souvent, mais pas toujours, lorsqu’ils évitent, par exemple, de s’interroger sur les causes propres du déclin du communisme, comme s’il s’agissait de raisons purement extérieures, ou de prendre pour argent comptant la « dérive libérale » de gouvernements qui ont accru la protection sociale dans un pays qui a le plus fort taux de prélèvements obligatoire en Europe… La lucidité vaut pour tout et tous.
Alain Bergounioux