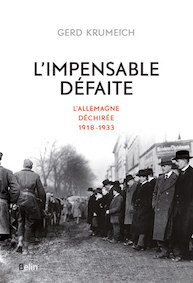 Gerd Krumeich, professeur émérite à l’université de Düsseldorf, a tissé très tôt des liens avec la recherche en France et il est devenu l’une des grandes figures des études sur la Première Guerre mondiale (aussi sur… Jeanne d’Arc à propos de laquelle il a déjà publié plusieurs ouvrages dont certains traduits). Déjà auteur du Feu aux poudres portant sur le déclenchement de la Grande Guerre, il s’intéresse aujourd’hui à la manière dont les Allemands appréhendèrent la défaite de 1918. À propos du livre de Gerd Krumeich, L’Impensable défaite. L’Allemagne déchirée, 1918-1933, Belin, 2019, 324p, 24€. Article paru dans L’OURS n°496, mars 2020, page 6.Quatre thèmes émergent d’un livre dense, pas toujours bien servi par sa traduction, faisant l’objet des quatre chapitres.
Gerd Krumeich, professeur émérite à l’université de Düsseldorf, a tissé très tôt des liens avec la recherche en France et il est devenu l’une des grandes figures des études sur la Première Guerre mondiale (aussi sur… Jeanne d’Arc à propos de laquelle il a déjà publié plusieurs ouvrages dont certains traduits). Déjà auteur du Feu aux poudres portant sur le déclenchement de la Grande Guerre, il s’intéresse aujourd’hui à la manière dont les Allemands appréhendèrent la défaite de 1918. À propos du livre de Gerd Krumeich, L’Impensable défaite. L’Allemagne déchirée, 1918-1933, Belin, 2019, 324p, 24€. Article paru dans L’OURS n°496, mars 2020, page 6.Quatre thèmes émergent d’un livre dense, pas toujours bien servi par sa traduction, faisant l’objet des quatre chapitres.
Une guerre maintenue à distance
Le premier, souvent répété dans l’ouvrage, surprend le lecteur français : selon Gerd Krumreich, l’opinion allemande, malgré les informations dont elle disposait, malgré le courrier, évidemment censuré qu’elle recevait, tint progressivement la guerre à distance (chapitre « La guerre lointaine »), préoccupée de plus en plus qu’elle était par les « charges extrêmes » pesant sur elle. La guerre, présentée dans le Reich comme défensive, ce que la majorité des Allemands croyaient, se déroulait hors du territoire national, les frontières n’ayant jamais été menacées, même lors des offensives alliées de la dernière année. L’auteur souscrit ainsi au jugement des administrations berlinoises assurant qu’une « partie énorme de la population » était « devenue totalement indifférente à la guerre », manifestant un désintérêt croissant pour la « défense nationale ». Les grandes grèves qui paralysèrent en 1917-1918 certaines industries allemandes le prouveraient, ainsi que les lettres envoyées aux soldats du front dans lesquelles les familles se plaignaient de leur propre condition de vie, particulièrement après l’« hiver des navets » (1916-1917), certaines missives demandant même aux soldats de leur envoyer de la nourriture. En tout cas, l’opinion allemande, malgré ses propres privations, du fait également de la censure militaire gommant la situation réelle des armées, ne se rendait guère compte des souffrances des soldats au front et encore moins de celles des civils français. Un journaliste accompagnant la délégation allemande aux négociations de paix nota la sidération des délégués à la vue des « ravages monstrueux » subis par les provinces françaises transformées pendant plusieurs années en champs de bataille.
Une défaite inenvisageable
D’autres facteurs peuvent aussi expliquer le sentiment très répandu dans l’opinion allemande que l’automne 1918 représenta une « étrange défaite » selon le titre du chapitre que Gerd Krumeich emprunte à Marc Bloch. Ainsi la grande offensive du printemps 1918 que l’état-major, en particulier Ludendorff, présenta trop vite comme la victoire décisive sur les Alliés. Si ces derniers subirent de très lourdes pertes – l’auteur estime à un tiers la proportion des troupes anglaises mises hors de combat – l’attaque s’enlisa avant d’être arrêtée par ses initiateurs deux semaines après son lancement, ce qu’ignora l’arrière. De même qu’il ne sut pas la chute de l’ardeur au combat des soldats allemands qui perdirent leur supériorité numérique à partir du 1er juillet 1918. Les troupes allemandes, au sein desquelles l’état-major avait eu la mauvaise idée de placer des ouvriers punis pour faits de grève, commencèrent une « grève militaire larvée », non par des mutineries, mais par une fuite du front, les soldats se dissimulant pour ne pas repartir au combat ou, pis encore, préférant se laisser faire prisonniers plutôt que de mourir dans une lutte désormais considérée comme absurde. Conscients que l’armée ne pouvait plus guère résister à la reprise des offensives alliées, les dirigeants militaires décidèrent des replis sur les frontières de 1914 et notamment sur la ligne Siegfried. Mais même si la victoire allemande semblait désormais impossible, la situation militaire, encore confuse en août-septembre, ne paraissait pas rendre la défaite proche. Du côté français, « personne, selon G. Krumeich, n’envisageait en septembre une fin imminente de la guerre ». C’est donc avec stupeur que les autorités civiles allemandes apprirent de Ludendorff la réalité que jusque-là il leur avait cachée. D’après l’auteur, « ni les syndicats les plus puissants, ni les sociaux-démocrates ne s’étaient faits à l’idée de la défaite ». Celle-ci paraissait d’autant plus inéluctable que l’Autriche-Hongrie se trouvait au bord de l’effondrement, tandis que la Bulgarie capitulait.
Le « coup de poignard dans le dos »
Ludendorff, peu désireux d’endosser la défaite, demanda alors qu’une offre soit faite au président Wilson, mais les réponses de celui-ci parurent inacceptables aux autorités tant civiles que militaires du Reich. Les bruits d’armistice accélérèrent alors l’« auto-dissolution » des troupes allemandes dont certaines se livrèrent même au refus d’obéissance. Les mouvements révolutionnaires en Allemagne et notamment la création par Kurt Eisner, social-démocrate indépendant, d’un « Conseil des ouvriers, paysans et soldats » à Munich qui essaima dans d’autres régions, précipitèrent les négociations d’armistice, la gauche allemande se persuadant que les Alliés seraient plus cléments envers un gouvernement « démocratique » qu’envers ceux de Guillaume II. De là naquit le thème du « coup de poignard dans le dos », véhiculé à l’origine par les militaires et sur lequel l’auteur ne prend pas vraiment parti, préférant évoquer les arguments des uns et des autres.
Enfin, dernier chapitre et dernier thème, celui de la résonance de la défaite en Allemagne. À ce titre, Gerd Krumeich fait un sort à l’idée de la « brutalisation » de la société européenne, devenue une tarte à la crème des manuels scolaires : pour lui, ce sont essentiellement les sociétés des pays vaincus, l’Allemagne en premier, qui connurent des violences extrêmes, mais par périodes. Il pointe aussi la responsabilité de certains, comme les dadaïstes, qui par l’outrance de leurs œuvres, particulièrement lors de la « foire internationale Dada » de l’été 1920, participèrent à la radicalisation de nombre d’anciens combattants. On songe alors à la « chasse aux officiers » de l’extrême gauche italienne qui favorisa des ralliements au fascisme. En tout cas, le « coup de poignard dans le dos » devint un des arguments favoris des nazis. La popularité d’Hitler après les victoires de 1940, spécialement contre la France, montre que l’opinion allemande dans sa majorité, mal informée, ne vivant la guerre qu’à travers les restrictions – le blocus allié dura d’ailleurs jusqu’au printemps 1919, provoquant selon l’auteur 100 000 morts supplémentaires parmi les civils allemands –, ne comprit pas la défaite de 1918.
Un livre riche de perspectives parfois nouvelles pour un lecteur français, dans lequel l’auteur se garde de tout avis péremptoire, comme il arrive trop souvent aux historiens d’aujourd’hui.
Jean-William Dereymez
