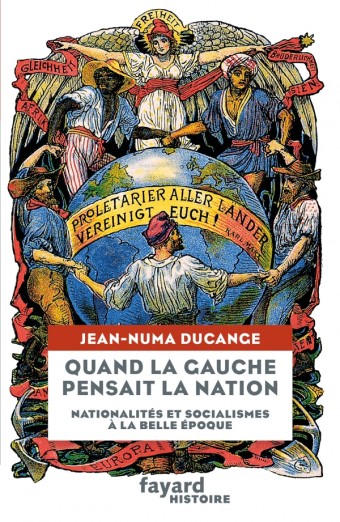L’ouvrage de Jean-Numa Ducange part d’un diagnostic partagé : le retour des nations, pour ne pas dire des nationalismes. Retour dans le débat public mais retour surtout dans l’actualité politique européenne, de la Hongrie à l’Italie, en passant par l’Angleterre et – bientôt peut-être – la France. Retour qui interroge en soi, après les promesses de l’ouverture d’une ère « post-nationale » consécutive à la chute du Mur et à l’accélération de la construction européenne. (a/s de Jean-Numa Ducange, Quand la gauche pensait la nation. Nationalités et socialismes à la Belle Époque, Fayard, 2021, 329p, 23€)
Ce retour semble surtout interroger, pour ne pas dire désemparer, les socialistes. Tel est le point de départ de cette passionnante enquête : « les forces politiques de gauche, issues de ce que l’on appelait le “mouvement ouvrier”, semblent circonspectes face à ces résurgences et flambées nationalistes ». L’objectif de l’auteur est donc d’exhumer un patrimoine oublié en replongeant le lecteur dans les controverses relatives à la nation et au principe de nationalité qui ont secoué les socialismes européens de la Belle Époque. Controverses dont ce livre restitue la richesse, les modalités de diffusion et l’influence réelle, quoi que trop souvent masquées par le mythe du retournement total d’un socialisme européen passant en une nuit de l’été 14 du « Prolétaires de tous les pays : unissez-vous ! » au soutien aux gouvernements d’union nationale. Au sein des socialismes européens, c’est surtout dans les débats du socialisme germanophone (allemand et autrichien), le « plus puissant courant socialiste du continent » d’alors, que puise l’auteur (à l’exception notable d’un sixième chapitre sur les sept de l’ouvrage consacré au socialisme français et aux variations, dans le socialisme germanophone notamment, de l’aura de sa tradition révolutionnaire et de son régime républicain). Un espace où « ont été formulées avec le plus de netteté des propositions politiques pour répondre aux questions posées par la combinaison entre une idéologie internationaliste revendiquée et les réalités nationales »; propositions qui eurent un écho dans tout le socialisme européen.
Le SPD, le SPÖ, l’IS et la nation
Les débats sur la question nationale dans l’aire du socialisme germanophone ont d’abord une préhistoire, sur laquelle revient le premier chapitre de l’ouvrage en s’intéressant principalement à deux scènes. D’abord, la tension présente au sein de l’Internationale entre une solidarité de classe aimantée par un horizon matérialiste de dépassement des nationalités et une action politique géographiquement localisée. Ensuite, la controverse, plus localisée, relative aux contours de l’unification allemande, question qui divise les figures du socialisme des années 1860 entre soutien à la « petite Allemagne » prussienne pour Lassalle et soutien à la « grande Allemagne » étendue à l’aire germanophone autrichienne pour Marx et ses partisans. La victoire prussienne de 1871 tranche matériellement la controverse en donnant à l’unification « petite allemande » – le Kaiserreich – une réalité que les socialistes ne peuvent négliger. Dès lors, socialisme allemand et socialisme autrichien vont se développer et s’institutionnaliser dans des espaces distincts, sans rompre totalement les liens pour autant.
Le deuxième chapitre est consacré à la plus célèbre des controverses du socialisme européen sur la question de la nation et des nationalités. En 1887, Karl Kautsky propose, depuis l’Allemagne, la première théorie socialiste de la nation, laquelle doit reposer sur un territoire et une langue propre. Ces nations, de diverses tailles, sont surtout, insiste-t-il, traversées par une dynamique d’intégration des plus petites dans les plus grandes, « à mesure que se développe le mode de production moderne, que s’approfondit la solidarité nationale des travailleurs, alors que s’amenuise la solidarité nationale entre ouvriers et capitalistes d’une même nation » ; L’horizon final étant celui d’une Mitteleuropa absorbée par l’Allemagne. La conception soulève quelques réserves, notamment côté autrichien, alors même que les nombreuses nationalités qui composent cette partie de l’Empire semblent de plus en plus aspirer à une certaine représentativité, autonomie, voire indépendance. Mais c’est Otto Bauer qui, après avoir étudié le phénomène national, le restitue en 1907 dans La question des nationalités et la social-démocratie. Sur la base d’une analyse socio-historique attentive aux dynamiques de réaffirmation des nationalités dans l’Empire (notamment la Tchèque face à l’Allemande) depuis le dernier quart du XIXe, Bauer dénie la dynamique historique d’absorption des petites nations. Plutôt que la germanisation des minorités, il recommande non pas l’éclatement mais une réforme de l’Empire attentive aux dynamiques des nationalités. La controverse est née. Jean-Numa Ducange en restitue l’ampleur et la richesse : la réponse de Kautsky, les interventions de Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Lénine et jusqu’à celle de Staline « envoyé pour étudier la question des nationalités au nom de son parti, en réaction aux thèses de Bauer, afin de livrer une définition de la nation qui soit plus nette que celle de Kautsky ». Ce dernier en tirera Le Marxisme et la Question nationale, et l’on comprend, dès lors, l’importance majeure de cette controverse pour le socialisme de la Belle Époque mais, plus largement, pour le XXe siècle en général.
Le droit des minorités
La question des nationalités de Bauer se veut aussi une charge contre une autre position en progression au sein du parti socialiste autrichien : une position hostile aux droits des minorités et à un internationalisme exacerbé qui confine au cosmopolitisme. S’engouffrant dans la brèche ouverte par le révisionnisme, des figures comme Engelbert Pernerstorfer et Joseph Bloch, et sa revue Sozialistische Monatshefte (Les cahiers mensuels du socialisme), dont l’auteur montre, dans le chapitre suivant, l’influence bien au-delà de la sphère germanophone et de l’espace socialiste proprement dits, défendent la position d’un socialisme dans une seule nation. La lutte contre ces tendances nationalistes, dans mais surtout à l’extérieur du socialisme, passe alors aussi, au sein du socialisme germanophone, par la promotion d’une contre-histoire de la nation allemande sur laquelle revient le quatrième chapitre. Ce faisant, l’auteur exhume les traces de ce qui, sans en avoir le nom, s’apparente à une histoire populaire précoce dans le socialisme germanophone. Protohistoire populaire qui est l’un des aspects d’une culture patriotique de classe, avec ses fêtes, sa mémoire et ses symboles, tels l’appropriation gauchisante de la figure de Schiller ou la commémoration de la révolution manquée de Mars 1848.
La question coloniale
Avec l’entrée dans le XXe siècle, un certain nombre de motifs nationalistes évoluent cependant. L’appréhension globalement négative des peuples slaves s’estompe, a fortiori après la Révolution russe de 1905, en même temps que l’intégration des différents partis socialistes à la vie politique les conduit à une confrontation au phénomène colonial. Dans ce contexte, la question de la capacité de la forme politique impériale, comparativement à la forme politique nationale (ou plutôt à la multiplication des petites nations à laquelle conduirait le démembrement des empires) à hâter l’avènement socialiste devient un enjeu théorique important ; enjeu qui conduit parfois certains socialistes à des positions nettement colonialistes. Mais l’auteur lève aussi le voile sur d’autres sons de cloche qui préfigurent l’ardeur de l’anticolonialisme de l’entre-deux-guerres. La période des dix années qui précèdent la Grande Guerre est également marquée par une interrogation sur la validité d’une forme nationale universelle, jusque-là essentiellement calquée sur les traits des modèles allemand ou ouest-européen, et également remise en cause à mesure que le socialisme se diffuse en « Orient », en l’occurrence au Japon, en Turquie, en Iran, en Inde ou encore en Chine, où il formule ses revendications populaires en puisant dans des traditions socio-politiques locales.
Bref, le cinquième chapitre de l’ouvrage revient sur les tournants dans l’actualité mondiale à partir de 1905 et démontre à quel point ce débat constitua un creuset de nouvelles réflexions et d’évolutions doctrinales. Enfin, après un court détour par la France, l’auteur conclu évidemment sur la Grande Guerre en restituant les tendances profondes qui contribuent à expliquer pourquoi l’internationalisme de la social-démocratie germanophone devait s’y fracasser ; quand bien même certaines positions socialistes ouvertement nationalistes continuent de se justifier au nom du sens de l’histoire et du rôle nécessaire de la victoire de la « Grande Allemagne » dans l’avènement d’un futur internationalisme. Surtout, le dernier chapitre décrit les recompositions et la thématisation, dans l’aile gauche de la social-démocratie allemande, d’un « internationalisme prolétarien » dont on sait l’avenir après-guerre. Un après-guerre où, entre Révolution de 17, effondrement des Empires et échec de l’Anschluss socialiste, une rupture profonde se dégage au regard des coordonnées des débats sur la nation de la Belle Époque. Une autre histoire donc, que l’auteur semble avoir prolongé dans son tout nouvel ouvrage – La République ensanglantée. Berlin, Vienne : aux sources du nazisme (Armand Colin) – sur lequel il faudra revenir.
Ce livre important de Jean-Numa Ducange est avant tout une histoire intellectuelle de la nation considérée du point de vue socialiste. Mais, au plus près des sources (extrêmement diverses qui plus est), il restitue les contextes d’élaboration des propositions théoriques et de réception des positions doctrinales en décrivant avec précision l’écosystème socialiste germanophone dans toute sa matérialité. Dès lors, l’histoire intellectuelle se fait aussi histoire sociale et politique et le lecteur se retrouve véritablement immergé dans un monde englouti. Apport précieux aux travaux historiographiques sur la nation et le nationalisme, mais apport également à l’histoire des échanges intellectuels transnationaux, ce livre offre à tous ceux qu’intéresse la question nationale – dont il est désormais superflu d’indiquer l’actualité – un support de grande valeur. Puisse les socialistes français s’en saisir. Ils trouveront là les traces d’un important patrimoine au tamis duquel passer leur (non) conceptualisation actuelle de la nation.
Milo Lévy-Bruhl
(article publié dans L’ours 523, décembre 2022)