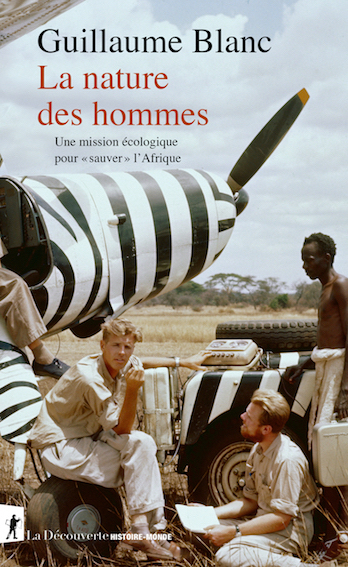Serengeti. Le nom seul du vaste game-park tanzanien suffit à ouvrir tout un imaginaire de nature encore vierge, miraculeusement préservée, mais si fragile… Qu’il faut se dépêcher d’aller visiter avant qu’il n’ait complètement disparu. Serengeti, trace ultime du paradis perdu, où le touriste occidental peut, nouvel Adam, nommer les animaux de la création : « Oh, des gnous !… des zèbres !… des éléphants !… » (a/s de Guillaume Blanc, La nature des hommes. Une mission écologique pour « sauver » l’Afrique, La Découverte, 2024, 327p, 23€
Cela ne date pas d’hier. En s’engageant dans la conquête du continent africain, les Européens obéissaient à deux injonctions, contradictoires en apparence. La première est connue : fournir à l’industrialisation les ressources en hommes et en richesses dont le continent était censé déborder ainsi que d’éventuels débouchés. La seconde l’est moins. Il s’agissait d’y préserver une nature naturelle, perdue pour l’Europe mais pensée comme intacte dans une Afrique préservée. Cette dimension « écologique » venant s‘ajouter à la kyrielle des bonnes intentions qui y ont présidé à la ruée sur le « continent noir » dont la plus notoire reste l’apport de « la » civilisation à des populations qui en auraient manqué. Dès 1933, à l’instar d’autres Anglo-Saxons qui, lancés dans l’exploitation effrénée du territoire américain, avaient créé le premier parc naturel du monde, les colonisateurs britanniques pour la plupart, réunis à Londres, décidaient de sanctuariser des portions de territoires de l’Est-africain pour y conserver, en toute « authenticité », une flore et une faune édéniques, comprenons sans présence humaine, comme le fut le paradis terrestre. Cela ne s’était pas fait sans mal ; la tension toujours vive entre tenants de la prédation et ceux de la protection des milieux africains tournant le plus souvent en faveur des premiers.
La colonisation après la décolonisation
Loin de désarmer, les seconds allaient tirer profit de la décolonisation pour imposer leur ordre écologique du monde. En Afrique à tout le moins. En 1961, la conférence d’Arusha dont Guillaume Blanc fait le point de départ de son travail rassemblait des nouveaux dirigeants des États indépendants ou sur le point de l’être, et ceux qu’il appelle les « diplomates-experts »1 pour discuter du projet spécial « d’aider l’Afrique à protéger sa nature », l’Afrique, pas les Africains. Tous Occidentaux, scientifiques souvent, ces défenseurs passionnés de la nature dont l’Afrique était pour eux le dernier réservoir, se prévalaient d’une expertise bientôt cautionnée par les grandes agences de l’ONU. Cette Afrique qu’ils continuaient de rêver comme la leur, les indépendances leur ont donné l’occasion de la promouvoir auprès des nouveaux dirigeants, plus faciles à convaincre que les administrateurs coloniaux. D’autant que la sauvegarde de la nature africaine était devenue un enjeu écologique. Au nom de la science ont perduré l’extension des parcs naturels, l’expulsion des populations, la chasse aux braconniers, aux surpâtureurs, aux allumeurs de brûlis, tenus pour responsables de la destruction du paradis : la violence contre les Africains toujours. Car c’étaient de ces derniers qu’il fallait protéger l’Afrique éternelle ! Trop nombreux, trop féconds, trop voraces, trop incompétents, pour ne pas dire incapables. Le projet colonial a ainsi prospéré après la décolonisation avec l’approbation voire le soutien des dirigeants africains.
Incapacité à penser l’avenir
Loin de se limiter aux initiateurs du Projet spécial africain, Guillaume Blanc consacre trois autres chapitres à ceux qui par un effet de ruissellement l’ont mis en œuvre ou l’ont subi : les anciens colons reconvertis en experts de terrain et qui ont conforté des position de pouvoir au plus haut des États décolonisés, gardiens de paradis, chargés des basses œuvres du projet ; les dirigeants est-africains adeptes plus ou moins convaincus du Projet à l’instar de Julius Nyerere qui s’il « ne souhaite pas passer (ses) vacances à regarder des crocodiles », se dit prêt à en faire « la plus grande ressource de revenus de son pays » du moment qu’ils plaisent aux touristes américains et aux européens ; enfin le dernier groupe, celui des paysans locaux, des expulsés, des sans-voix, des résistants, des débrouillards, des survivants dont le dernier chapitre offre quelques portraits. Ceux-là ne sont pas les rêveurs, tous se sont accommodés du rêve de ceux qui souhaitaient mettre l’Afrique sous cloche. Si ce compte-rendu leur réserve la portion congrue, c’est parce que la « mission écologique pour sauver l’Afrique » des diplomates-experts nous semble une formidable démonstration de la nocivité des idéologies, ici appelées « rêves » parce qu’il est question de paradis, et de leur incapacité à envisager l’avenir. Les préservationnistes se sont trompé de menace. Le glacier du Kilimandjaro et la faune qu’il hébergeait ont quasiment disparu. Pas du fait des Africains qui le subissent, mais du réchauffement climatique. Ultime cadeau du Nord développé, le Nord des gentlemen-experts.
Françoise Gour
article paru dans L’ours 535 mai juin 2024
1 – Concept emprunté à l’historien néerlandais Raf de Bont qui, lui, parle de « Nature’s diplomats ». Le lecteur notera l’emploi du génitif saxon qui fait de la nature une personne.